
Altercation entre salariés et obligation de sécurité de l’employeur
Querelle entre salariés : l’obligation de sécurité de l’employeur renforcée
Par un arrêt récent de la Chambre sociale rendu le 17 octobre 2018 (Pourvoi n° 17-17.985), la Cour de cassation se positionne sur les contours de l’obligation de sécurité de l’employeur au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par le biais de cet arrêt, elle renforce un peu plus cette obligation à la charge de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Tour d’horizon.
Employeur : obligation de prévention des risques pour les salariés
En l’espèce, une altercation a lieu entre deux salariés, suivie d’une agression verbale ayant entraîné un préjudice moral avec soins pour le salarié victime, mais sans arrêt de travail. Afin de résoudre ce différend, l’employeur décide d’organiser une réunion dès le lendemain de l’altercation ainsi que d’autres réunions les moins suivants. Plusieurs mois après ce premier différend, l’auteur de la première agression récidive avec le même salarié. Ce dernier saisit la juridiction afin d’obtenir des dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi. La Cour d’appel fait droit à sa demande, sur la base du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Les juges du fond estiment en effet que l’employeur n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour prévenir le risque de récidive. La question était alors posée à la Cour de cassation de savoir si l’employeur était tenu dans cette situation de prendre d’autres mesures afin de prévenir une nouvelle altercation. Les juges répondent par l’affirmative et confirment la décision de Cour d’appel. Les juges considèrent en effet que l’employeur était tenu de prendre des mesures concrètes pour éviter tout renouvellement du différend entre les deux salariés, ce dernier ayant eu connaissance des conséquences immédiates de l’altercation sur la santé du salarié victime ainsi que des caractères incompatibles des protagonistes sources possibles d’un nouveau conflit. Or, en organisant seulement une réunion après l’altercation, suivie d’autres réunions périodiques, l’employeur n’avait pas pris de mesure concrète. Ce dernier est donc responsable et a manqué à son obligation de sécurité en n’ayant pas opté pour des mesures de prévention et de protection suffisantes, au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.
Obligation de sécurité de l’employeur : appréciation des mesures devant être prises
Par cet arrêt rendu le 17 octobre 2018, la Cour de cassation précédée de la Cour d’appel est catégorique sur le sujet : le fait pour un employeur d’organiser des réunions entre deux salariés à la suite d’une querelle ne suffit pas à remplir l’obligation de sécurité telle que prévue par le Code du travail. Face à ce constat, il est possible de se demander quels auraient dû être les moyens d’action de l’employeur face à pareille situation. Pour rappel, l’article L. 4121-1 du Code du travail précise que l’employeur doit assurer la sécurité des travailleurs et protéger leur santé physique et mentale. Cette obligation prend en compte la mise en place de plusieurs mesures, à l’instar des actions de formation, de prévention et d’information. Il s’agit aussi pour l’employeur de mettre en place une organisation et des moyens adaptés afin de prévenir les problèmes éventuels et améliorer les situations existantes. Pour condamner l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, les juges sont tenus de rechercher s’il a pris les mesures permettant réellement de faire cesser tout risque pour le salarié ou, le cas échéant, de l’éviter à l’avenir. Suivant la position déjà rendue par un arrêt du 25 novembre 2015 (Pourvoi n° 14-24.444), la Cour de cassation aurait peut-être jugé différemment si l’employeur avait pris en compte le risque de récidive de cet employé indélicat et les conséquences morales qui avaient déjà été constatées dans le cadre de la première altercation
![]()
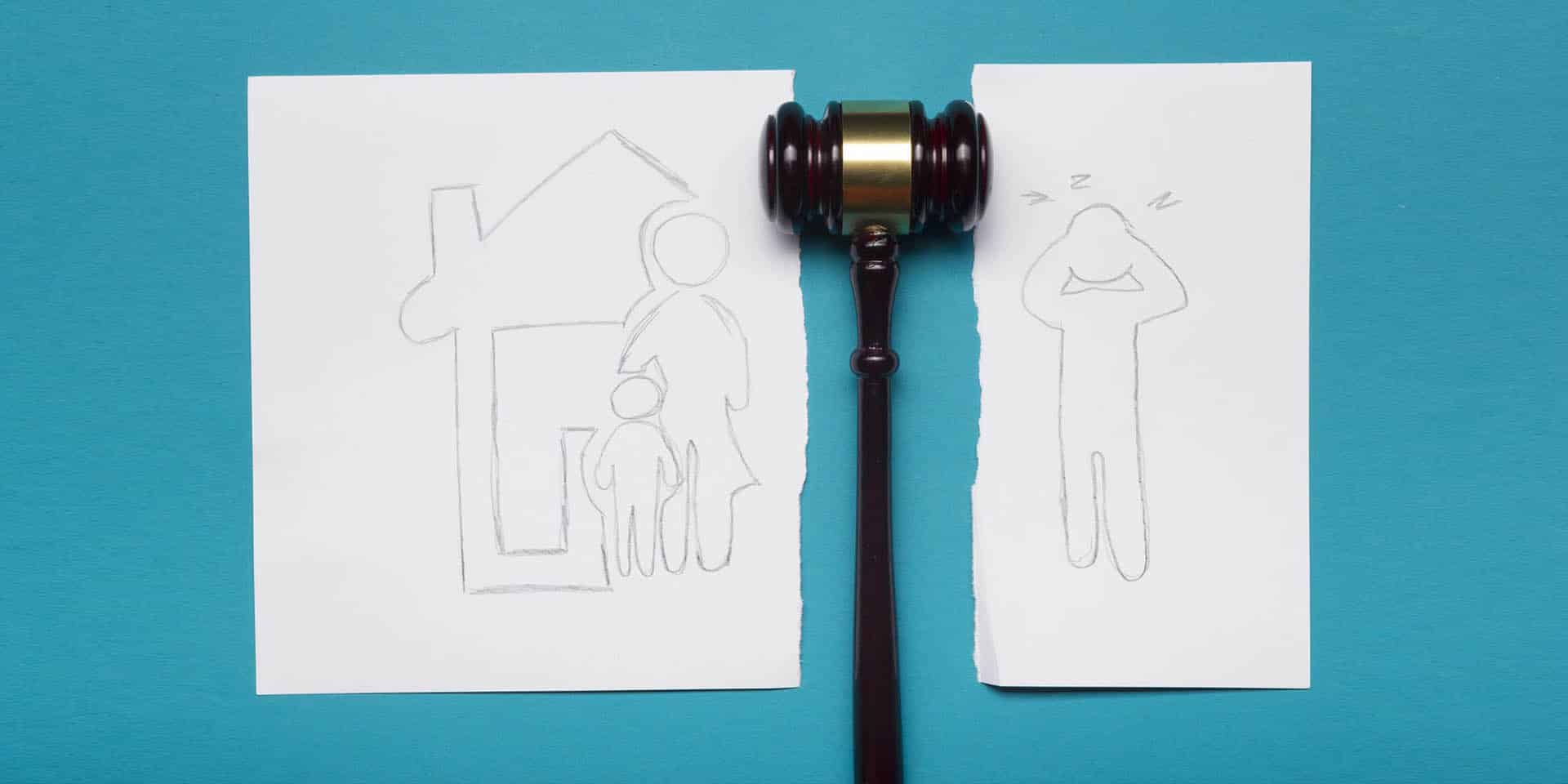
Le sort du domicile conjugal en cas de divorce des époux
La protection du domicile conjugal dans le cadre du divorce
Une procédure de divorce emporte des conséquences plus ou moins importantes pour l’ensemble de la famille, et notamment le couple. Le sort du domicile conjugal, ancien lieu de communauté de vie entre les époux au sens de l’article 215 du Code civil, est particulier. En effet, en cas de conflit, c’est au juge de fixer cette résidence selon les intérêts de la famille. Que devient le domicile conjugal en cas de divorce des époux ? Est-il possible de le vendre ? Cet article fait la lumière sur ces questions.
Procédure de divorce : un époux peut-il vendre le domicile conjugal ?
Sur la question de savoir si un des époux peut, de sa propre volonté, procéder à la vente du logement ayant constitué le domicile conjugal, la législation française est particulièrement claire. L’article 215 du Code civil, dans son troisième alinéa, précise à cet effet que la vente du domicile conjugal durant la procédure de divorce suppose l’accord des deux époux. Il en va de même des meubles composant ce logement. Ainsi, si l’un des époux n’a pas donné son consentement à la vente du bien, il est en droit de demander l’annulation de l’acte. Pour agir en nullité il dispose d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte de vente. Dans tous les cas, il lui est impossible d’agir au-delà d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Si les deux époux étaient locataires du domicile conjugal et qu’ils entament une procédure de divorce, ils ne peuvent pas, l’un sans l’autre, résilier le bail portant sur le logement familial. Les deux époux sont en effet cotitulaires du bail, en vertu de l’article 1751 du Code civil.
Les exceptions à l’accord des deux époux sur le domicile conjugal
Il peut arriver qu’un époux souhaite vendre le domicile conjugal ou mettre un terme au bail sans pour autant obtenir l’accord de son conjoint. Dans le cadre d’une procédure de divorce il n’est en effet pas rare de voir apparaître des divergences de ce type. Comment faire pour procéder tout de même à l’acte sans encourir la nullité ? L’article 217 du Code civil peut s’appliquer dans certaines situations et intervient à défaut de consentement des deux anciens conjoints. Il s’agira principalement de savoir si le refus s’oppose à l’intérêt de la famille. Ainsi, un époux peut parfaitement être autorisé à vendre le logement familial sans l’accord de son conjoint si ce dernier n’est pas en mesure de manifester sa volonté ou que son désaccord est injustifié au regard de l’intérêt de la famille. C’est par exemple le cas si un des époux connaît une situation importante de surendettement uniquement susceptible d’être apurée par la vente du domicile conjugal, après que ce dernier ait vendu ses biens propres. Dans ce cas, la vente est opposable à l’autre époux qui a refusé l’acte mais ne l’engage pas dans le paiement d’une quelconque dette rattachée à l’acte. Il est à noter que l’attribution de la jouissance du logement familial à l’un des deux époux n’empêche pas l’autre époux d’en demander la vente.
![]()

Focus sur la déjudiciarisation en droit du travail
La déjudiciarisation en droit du travail
Est appelée déjudiciarisation le fait de ne pas avoir systématiquement recours au judiciaire en privilégiant d’autres voies, comme le traitement social ou la médiation. Appliquée au droit du travail, cette baisse des contentieux fait grincer quelques dents. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? En la matière, il n’existe aucune réponse unique. Ayant débuté avec la recrudescence des ruptures conventionnelles homologuées nées sous le signe du sacrosaint consensus, la déjudiciarisation revêt aujourd’hui des visages divers en droit du travail. Zoom sur ce phénomène qui ne fait pas que des adeptes.
Une déjudiciarisation à l’origine d’une baisse de contentieux sociaux
La loi du 25 juin 2008 est venue reprendre cette idée de déjudiciarisation en multipliant les précautions et les garanties pour les parties. L’objectif affiché était alors d’éviter autant que possible tout contentieux. Les délais de réflexion et de rétractation ont ainsi été rallongés. Cette loi a permis de faire baisser de 40 000 le nombre de contentieux prud’homaux en l’espace de 5 ans (plus précisément entre 2009 et 2014).
Avec l’arrêt rendu le 23 mai 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a sécurisé cette déjudiciarisation en venant préciser que la validité de toute convention de rupture conclue entre les parties n’est pas remise en cause par l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail. Cet arrêt rendu, l’ère a véritablement été celle d’un renouveau, celui du désengorgement des tribunaux prud’homaux, avec un record en 2017 de 432 000 homologations délivrées.
Le barème des dommages-intérêts issus de la déjudiciarisation
Le barème des dommages-intérêts prévus dans l’hypothèse d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas du goût de tout le monde. Cette mesure majeure est née des ordonnances du 22 septembre 2017 destinées à remodeler le droit du travail en faveur d’une déjudiciarisation. Le plafond a été établi en fonction de l’ancienneté du salarié : 1 mois de salaire brut pour une ancienneté inférieure à 1 an et 20 mois de salaires bruts maximum pour une ancienneté supérieure à 30 ans. Le plancher est fixé à 3 mois minimum pour une ancienneté supérieure à 2 ans sauf pour une entreprise ayant une trésorerie fragile ou comptant moins de 11 salariés.
Les précautions prises pour encadrer la déjudiciarisation en droit du travail
Mais que cache réellement cette déjudiciarisation dans le monde du travail ? Nombreux sont ceux à estimer que le consensus entre salarié et employeur cache souvent une démission ou un licenciement abusif. N’en déplaise à ses détracteurs, la déjuridictionnalisation a atteint son objectif, également en matière de protection du salarié. L’administration contrôle désormais la procédure, ce qui a fait que le contentieux devant le Tribunal de Grande instance est désormais de 8 % en comparaison avec les 21 % d’il y a quelques années.
Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017, la rupture conventionnelle collective se pare de trois consentements successifs, dans un objectif de protection du salarié. Cette rupture conventionnelle revisitée est alors une synthèse entre les nombreuses évolutions ayant entouré la déjudiciarisation depuis son introduction en droit du travail.
Désormais, les trois consentements successifs sont les suivants :
- un premier consensus avec les syndicats
- un second consensus avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), cette dernière vérifiant notamment que la rupture n’a pas pour origine une éventuelle discrimination
- l’accord éclairé du salarié.
![]()

Nullité de la transaction de rupture après une remise en main propre du licenciement
Nullité de la transaction après la remise en main propre de la lettre de licenciement
En droit du travail, on appelle transaction le contrat par lequel salarié et employeur mettent un terme, par concessions mutuelles, à toute contestation antérieure ou à naître, en lien avec la rupture du contrat de travail. Elle est encadrée par l’ article 2044 du Code civil.
Dans un arrêt de Cour de cassation en date du 10 octobre 2018, la Haute juridiction a estimé qu’une transaction ayant lieu après la rupture du contrat de travail n’est valable que si le licenciement a été notifié par voie de courrier recommandé avec avis de réception.
Déroulement des faits
Toute transaction présuppose que le contrat de travail ait été rompu au préalable puisque son objet est précisément de mettre un terme définitif à toute possibilité de contestation liée à la rupture du contrat. Par son biais, les deux parties s’entendent pour ne pas remettre en cause de quelque manière que ce soit la décision prise ni aucune disposition contractuelle.
En l’espèce, un salarié se fait licencier par son employeur et signe le reçu de remise en main propre de la lettre de licenciement. Deux mois après le licenciement du salarié, l’employeur décide de conclure avec ce dernier un protocole transactionnel. Le salarié signe ce protocole puis en conteste la validité en saisissant les Prud’hommes.
La Cour d’appel saisie de cette affaire (en l’occurrence la Cour d’appel de Basse-Terre) considère que la transaction est valable puisqu’elle a été conclue à la suite de la notification du licenciement au salarié. Elle déboute le requérant de sa demande.
Le protocole transactionnel : un acte soumis à un strict formalisme
Le salarié forme un pourvoi en cassation. Au visa de l’ article L. 1231-4 du Code du travail et L. 1232-6 de ce même Code, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que cette transaction a été conclue par les deux parties en l’absence de notification du licenciement par voie de lettre recommandée avec avis de réception. De ce fait, il en résulte que la transaction est nulle.
La Jurisprudence part du principe qu’une transaction peut tout à fait être valable. Encore faut-il en fixer les contours. En la matière, la Cour de cassation vient apporter une lumière sur le formalisme devant entourer cette rupture afin de rendre la transaction valable.
La question qui était posée aux juges était ici de savoir si une transaction conclue après la notification d’un licenciement par remise en main propre était ou non valable.
Pour répondre à cette question, les juges ont établi que cette transaction, afin d’être valable, doit être conclue après la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En l’absence de ce formalisme, la transaction est donc considérée comme nulle. Une simple remise en main propre au salarié, même contre signature, ne suffit pas.
Cette solution respecte tout particulièrement le formalisme tel qu’imposé par l’article L. 1232-6 du Code du travail et selon lequel l’employeur est tenu de notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une volonté de protéger le salarié licencié
Cette position de la part des juges n’est pas isolée. En effet, elle vient confirmer sa position constante, notamment dans un arrêt rendu le 5 mai 2010.
On pourrait légitimement se demander quelles sont les raisons d’une telle décision, dans la mesure où on pourrait penser qu’une remise en main propre suffit pour que le salarié prenne connaissance de son licenciement. En réalité, il apparaît que l’avantage de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception est de permettre au salarié licencié d’avoir une pleine et entière connaissance des motifs de son licenciement. Or, cela n’est pas forcément le cas lorsque le licenciement est notifié au salarié par une remise en main propre. L’objectif des juges est donc de protéger le salarié licencié, la transaction ayant pour conséquence de rendre impossible toute contestation. Cela ne remet nullement en cause la validité de tout licenciement mais bien de toute transaction conclue après le licenciement. Il est ainsi acquis de manière constante que la notification au salarié de son licenciement par une lettre remise en main propre ne requalifie pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc hautement conseillé aux employeurs de notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir conclure une transaction postérieurement.
![]()

Médiation : Comment gérer ses problèmes de voisinage
Médiation : Comment gérer ses problèmes de voisinage
Comme prévu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Et pourtant, on estime que 2 français sur 3 subissent ou subiront un jour des nuisances de voisinage, véritable fléau de la densification croissante des villes et campagnes. S’il est souvent considéré qu’elles constituent une fatalité fasse à laquelle il est difficile d’agir, le droit ne demeure pas en reste et offre des possibilités d’action permettant de faire valoir ses droits, et cesser ces problématiques qui sont parfois susceptibles de dégrader fortement votre quotidien, privant les victimes d’une jouissance paisible de leur logement qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement. Car si ce phénomène touche davantage les copropriétaires, il n’épargne pas les logements individuels et les quartiers pavillonnaires.
La jurisprudence au secours de la quiétude au quotidien
C’est à travers un arrêt rendu le 19 novembre 1986 que la 2e chambre civile de la Cour de cassation est venue créer la notion de trouble anormal de voisinage (pourvoi 84-16.379): “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, instaurant un double principe d’exonération de responsabilité pour le résident dont les activités demeurent en-deçà d’un seuil de tolérance, alors que la 2e permet l’engagement automatique de la responsabilité de celui qui dépasse ce même seuil : le fait générateur est ainsi plus important que le préjudice en lui-même.
En effet, la vie en communauté pousse à établir un rapport d’équilibre entre les nuisances rendues nécessaires par la vie quotidienne (qu’elles soient sonores, visuelles ou olfactives). L’abus de droit de propriété et le trouble anormal de voisinage sont ainsi caractérisés lorsque cet équilibre est rompu, et ce même si aucune faute caractérisée n’est commise. La Cour d’appel d’Amiens est venue préciser dans un ancien arrêt de 1932 que nul n’est en droit d’imposer à ses voisins « une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage ». De la musique à fond à toute heure, aux hurlements répétés, bruits de meubles ou de coups intempestifs, barbecue sur le balcon, commerce ou activités mitoyennes bruyantes… les exemples possibles sont nombreux.
Quelle procédure engager face aux troubles de voisinage ?
La première démarche à engager est bien entendu amiable. Il est possible qu’avec un simple dialogue les choses puissent rentrer dans l’ordre, et que le voisin responsable des nuisances n’ait tout simplement pas conscience (volontairement ou non) du préjudice qu’il provoque. Si le dialogue verbal ne suffit pas, il convient alors de constituer un dossier écrit à travers l’envoi dans un premier temps d’un courrier simple, suivi d’une mise en demeure avec rappel de la législation (notons ici que le tapage diurne est tout aussi prohibé que le tapage nocturne!) par courrier recommandé avec accusé de réception si la situation n’évolue pas favorablement.
Lorsque cette première phase directe entre la victime et le responsable des nuisances ne suffit pas, il est alors possible de faire appel à un médiateur, dont la saisie s’effectue directement en mairie. Ce médiateur convoque alors les parties et tente depuis son regard extérieur et en terrain neutre de trouver une solution durable. Mais il ne dispose d’aucun pouvoir de police ou même de contrainte : il ne peut obliger les parties à se rendre à sa convocation. Si la démarche reste amiable, son caractère plus officiel permet généralement de régler le conflit.
Le troisième recours possible en cas d’échec est alors le maire de la commune, garant de la tranquillité publique et en mesure de diligenter les moyens nécessaires pour constater et faire cesser le trouble, notamment grâce aux forces de police municipale (police du quotidien et du cadre de vie), mais également des autres forces de sécurité disponibles et éventuellement de spécialistes tels que des acousticiens et inspecteurs de salubrité publique. Lorsqu’ils constatent le trouble anormal de voisinage, ils sont en mesure de prendre des mesures immédiates de rappel à l’ordre et en dernier lieu de saisir le Procureur de la République.
L’ultime recours reste celui porté devant les juridictions civiles (saisie du tribunal d’instance ou de grande instance, si le préjudice estimé est supérieur à 10 000€), ou pénales (dépôt de plainte) afin de faire valoir ses droits devant un juge, et obtenir une indemnisation ainsi qu’une sanction financière pour le responsable.
Enfin, rappelons que le propriétaire bailleur est responsable de son locataire, qui n’est pas exonéré des obligations de jouissance paisible sur le motif qu’il n’est pas propriétaire. Ainsi, depuis la loi 2007-297 du 5 mars 2007, le propriétaire est en droit de résilier le bail à tout moment en cas de troubles de voisinage établis. Lorsqu’il n’intervient pas auprès de son locataire pour faire cesser le trouble, il peut même engager sa responsabilité à l’égard du tiers lésé.
![]()

Fraude à la TVA : Le principe et les risques de redressement fiscal
Fraude à la TVA : Le principe et les risques de redressement fiscal
La fraude fiscale est définie par le Code général des impôts (article 1741) comme le fait de se soustraire ou tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts. Étendue à la TVA, la fraude à la TVA consiste donc pour un contribuable d’échapper de manière volontaire et frauduleuse, caractérisant en outre la mauvaise foi, aux obligations de collecte en matière de TVA. Pénalement répréhensible, elle représente un manque à gagner pour l’État d’environ 14 milliards d’euros, poussant ainsi Bercy à multiplier les contrôles et les redressements face aux situations frauduleuses relevées par ses agents.
Principe de la fraude à la TVA
Toute personne morale qui importe et/ou vend une prestation de services ou un bien collecte de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qu’elle doit ainsi reverser à l’État. La fraude à la TVA est constituée par l’absence de reversement des montants dus à l’État (partiellement ou totalement), représentant ainsi juridiquement un enrichissement sans cause, notion issue de la jurisprudence avant sa codification dans le Code civil.
La fraude à la TVA peut parfois masquer de véritables montages frauduleux caractérisant la mauvaise foi, à travers la constitutions de société éphémères ou fictives, voire des montages. La fraude peut donc être simple ou plus complexe, constituer une simple erreur de bonne foi (mauvaise connaissance des règles, notamment sur les régimes spécifiques de TVA réduite, par exemple) ou à l’inverse démontrer l’intention manifeste de frauder.
La fraude à la TVA peut également être constituée lorsqu’une entreprise importe des produits provenant d’un pays étranger membre de l’Union européenne sans payer de TVA (exonération de TVA intracommunautaire), tout en collectant une TVA à la revente, non versée à l’État. Enfin, la fraude peut être plus élaborée, et s’organiser entre plusieurs entités afin d’obtenir remboursement par un État de l’Union d’une TVA jamais collectée, ou d’en réduire le montant.
Comment s’organise la lutte et la sanction des fraudes à la TVA ?
Face au manque à gagner considérable, mais également à l’enrichissement sans cause des fraudeurs sur une TVA devant revenir à l’État, collecté sur le dos des acquéreurs, et non reversé, le Ministère de l’économie a décidé de lancer une offensive de lutte contre ces comportements frauduleux, à travers un plan en 3 volets, comportant des sanctions qui peuvent s’avérer dissuasives, mais également un système de dénonciation rémunérée, et des contrôles renforcés.
Le Code général des impôts prévoit une sanction lourde pour le délit de fraude à la TVA, de part une amende pouvant atteindre 75 000€ ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 5 ans pour la personne physique ou le représentant légal de la personne morale en cause. Il est également possible de caractériser le délit d’escroquerie défini et sanctionné à travers les dispositions du Code pénal.
La loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 adoptée en vue de la loi de finances 2017 constitue un fait marquant du plan de lutte gouvernemental contre la fraude à la TVA, grâce à la rémunération désormais instaurée pour les dénonciations permettant aux services administratifs de Bercy de constater et établir une fraude. Le montant de cette rémunération est fixé par le directeur général des Finances publiques, sur proposition du directeur de la direction des enquêtes fiscales (DNEF), et tient compte de l’ampleur de la fraude dénoncée.
Enfin, notons qu’un volet numérique a été instauré dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, à travers l’obligation d’usage de logiciels sécurisés et certifiés (article 88 de la loi de finances 2016) par l’Administration fiscale. L’absence d’attestation ou d’usage d’un logiciel de facturation agréé peut entraîner une amende de 7 500€. Enfin, Bercy s’est doté d’un logiciel de détection des fraudes utilisant un mécanisme d’algorithme précis, basé sur les éléments composant généralement les fraudes constatées, et utilisant donc l’expérience acquise par les inspecteurs.
![]()

Faire justice soi-même : Ce que vous encourez
Faire justice soi-même : Ce que vous encourez
Se faire justice soi-même, une réaction humainement compréhensible, mais pourtant juridiquement pénalement sans aucun fondement et dès lors répréhensible. Un choix qui peut donc s’avérer particulièrement risqué. Se pose alors automatiquement la notion liée de légitime défense : un acte violent peut-il être légitime ou engage-t-il automatiquement la responsabilité de son auteur, même lorsqu’il s’agit d’une réaction (on parlerait à ce propos plutôt d’une vengeance) à un fait lui-même violent ?
Régulièrement secouée par des affaires de vengeance ou de légitime défense, l’opinion publique se voit ainsi contrainte de relancer le débat de la justice « maison » (Comme notamment l’affaire du bijoutier de Nice, qui avait abattu son braqueur). Face aux accusations récurrentes d’une justice trop lente et laxiste, la tentation est parfois grande. Et pourtant…les risques juridiques sont bien présents, et loin d’être légers.
La question posée de la légitime défense
Seule une intervention ou action violente répondant à la légitime défense saurait être permise par le droit français. Ainsi, le Code pénal dispose en son article 122-5 que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. ». Autrement dit, il est possible dans une situation bien précise de se faire justice à soi-même, à travers un cadre légal très précis. Celui-ci impose donc une réaction proportionnée à l’atteinte, mais également qu’elle soit dictée par une menace réelle et immédiate (excluant ainsi les menaces verbales), mais également injustifiée (une réaction de légitime défense face à une riposte elle-même menée en légitime défense n’est naturellement pas recevable). L’acte de défense doit donc être rendu nécessaire dans le seul but de se protéger ou préserver ses biens, et proportionné à l’agression subie. Enfin, la riposte doit intervenir immédiatement au cours de l’agression, et non à l’issue de celle-ci : tirer sur un cambrioleur en fuite ne peut aucunement constituer un acte de légitime défense.
Il est également possible qu’une réaction violente soit en mesure d’entrer dans le cadre de la présomption de légitime défense posée par le Code pénal, même si les critères précédents ne sont pas remplis. Il s’agit des actes violents effectués pour repousser une entrée par effraction, violence ou ruse dans son logement, ou encore en guise de défense face aux auteurs d’un vol ou pillage violent (article 122-6 du Code pénal).
Enfin, il est tout autant possible de réagir de manière violente face à un péril actuel ou imminent menaçant soi-même, autrui ou encore un bien (art. 122-7 du Code précité), et à condition que cet acte soit nécessaire pour y mettre fin, mais ici aussi, que cette réaction soit proportionnée à la gravité de la menace avérée.
En dehors de ce cadre très strict, aucune action violente ne saurait être légitimée par le droit, et risque d’engager la responsabilité pénale de son auteur, quel qu’en soit le degré prétendu de légitimité.
La vengeance, notion non admise en droit pénal français
Si dans certains systèmes juridiques la loi dite du talion (« œil pour œil, dent pour dent ») est reconnue et utilisée par les autorités judiciaires, il n’en est rien en France. Ainsi, dans notre droit positif, tout fait violent non justifié par la légitime défense ne saurait être admis, et engagerait ainsi automatiquement la responsabilité (pénale et civile) de son auteur. C’est pourquoi il n’est pas si rare de voir des tribunaux prononcer des peines à l’encontre d’une victime d’agression, condamnée à réparer le préjudice de son agresseur initial à la suite d’une vengeance.
Néanmoins, il apparaît souvent que les juridictions pénales françaises, et en particulier les jurys de cour d’assises s’appuient sur le principe de l’intime conviction pour prononcer des peines soit extrêmement légères (symboliques), soit inexistantes (acquittement) à l’encontre des auteurs d’individus ayant souhaité se faire justice par eux-mêmes. Ces décisions juridiquement intenables sont bien entendu conditionnées par l’affect et notamment l’émotion suscitée auprès de l’opinion publique qui n’hésite généralement pas à prendre la défense de ces individus face à leurs agresseurs initiaux (le fameux « il n’a que ce qu’il mérite »).
Rappelons néanmoins que juridiquement, l’engagement de la responsabilité civile et pénale d’un individu ayant cherché à se faire justice lui-même peut entraîner des sanctions extrêmement lourdes, telles que la réparation du préjudice et le versement de dommages et intérêts, mais également des peines d’emprisonnement et d’amende, sur la base des sanctions propres à chaque fait délictueux ou criminel, tel que qualifié par le Code pénal. Ainsi donc, le meilleur moyen de se faire justice soi-même tout en restant dans les règles, est la saisine des instances judiciaires compétentes, afin de faire valoir ses droits, et obtenir la réparation légitimement attendue.
![]()

Accident du travail : Qui porte la responsabilité et sous quelles conditions ?
Accident du travail : Qui porte la responsabilité et sous quelles conditions ?
Tout accident survenu au cours des horaires de travail et sur le lieu de travail est réputé comme constituant un accident professionnel (article L411-1 du Code de la sécurité sociale) sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’en apporter la preuve. Il peut bien entendu en être de même après enquête, et selon les circonstances, lorsque cette présomption n’est pas applicable (L411-2 du même Code). Ce régime protecteur issu des dispositions de la loi du 9 avril 1898 permet au salarié victime de bénéficier d’une prise en charge des soins et de ses revenus à travers une indemnité de base susceptible d’être complétée sous conditions par l’employeur. L’accident du travail peut également engendrer l’engagement de la responsabilité civile de l’employeur au titre du manquement à son obligation de sécurité, mais également pénale dans le cadre de fautes graves ou inexcusables définies aux articles L452-1 et suivants du Code précité.
Qui est responsable en cas d’accident du travail ?
Par défaut, l’accident (ou maladie) du travail permet au salarié victime de percevoir une indemnisation limitée, sans qu’aucune responsabilité ne soit établie spécifiquement. Mais dans certains cas, il peut être rendu possible de démontrer la faute de l’employeur, pouvant dès lors constituer une faute inexcusable ouvrant droit au salarié à une indemnisation majorée mais surtout, engageant la responsabilité civile, voire pénale dans les cas les plus graves de ce dernier.
En effet, l’indemnisation apportée au salarié de manière automatique démontre indirectement l’existence d’une obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur. Cette notion issue d’un arrêt de cassation de 1911 a été interprétée assez largement par la jurisprudence comme constituant une « obligation générale de sécurité ». La seule cause d’exonération de toute indemnisation de la part de l’employeur étant la preuve rapportée par celui-ci d’une faute du salarié, ou d’une cause totalement étrangère au travail réalisé, il est ainsi établi l’existence de cette obligation de résultat pesant sur l’employeur en matière de sécurité du salarié. Obligation de résultat qui a depuis était clairement établie par la Cour de cassation, par exemple à travers un arrêt rendu le 27 novembre 2014.
L’engagement de la responsabilité civile ou pénale de l’employeur
Au-delà de l’indemnisation de base accordée de plein droit par le droit positif au salarié victime d’un accident du travail, il est rendu possible pour ce dernier d’engager la responsabilité civile de l’employeur, à condition de rapporter la preuve de sa faute. Faute étant constituée lorsque toutes les obligations légales relatives au Code du travail n’ont pas été respectées, mais encore en cas de faute inexcusable. L’engagement de cette responsabilité permet au salarié de bénéficier d’une réparation de son préjudice sous la forme de dommages et intérêts perçus en complément de l’indemnité de base, versée soit par la personne morale employant le salarié, soit par l’assurance responsabilité civile de l’employeur.
Plus grave encore, lorsqu’une obligation d’ordre public en matière de sécurité ou de droit pénal (ex : harcèlement ayant entraîné un accident du travail) n’a pas été respectée, la responsabilité pénale de l’auteur direct de l’infraction, c’est-à-dire de l’employeur en tant que personne physique, est engagée même s’il n’est pas directement responsable de l’accident. En effet, la jurisprudence est constante sur le sujet : c’est à l’employeur que revient notamment la mission de veiller à l’application de toutes les règles d’hygiène et de sécurité, à moins qu’il ne délègue cette fonction à un organe spécifique : le CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). L’engagement de la responsabilité pénale de l’employeur peut engendrer des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement assorti d’une amende de 75 000€ en cas de préjudice grave et durable, et si l’employeur est convaincu d’un fort degré de responsabilité dans la survenue de l’accident.
La responsabilité de l’employeur peut être engagée par le salarié à travers une demande de reconnaissance de faute, effectuée auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans un délai de deux ans suivant la survenue du préjudice. Une médiation ainsi que la conclusion d’un accord amiable sont alors prévus, avant une transmission de l’affaire en cas d’échec au tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) qui est seul compétent en la matière.
![]()

Vous êtes victime d’une erreur médicale ? La procédure à suivre.
Vous êtes victime d’une erreur médicale ? La procédure à suivre.
Infection suite à une intervention chirurgicale, effets indésirables lourds liés à la prise d’un traitement… Les cas peuvent être très divers. Plus grave encore, d’après un rapport du Sénat rendu en 2013, près de 60 000 décès par an seraient liés de près ou de loin à une erreur médicale. Un chiffre difficile à vérifier, mais qui traduit néanmoins un risque qui n’est pas aussi marginal que l’on pourrait croire. Les professionnels de santé sont en effet loin d’être infaillibles car ils restent des êtres humains, mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne sont pas susceptibles d’engager leur responsabilité dans certains cas d’erreur médicale, ouvrant droit à une indemnisation, mais également à une potentielle procédure de sanction. Dès lors se pose régulièrement pour les victimes concernées la question de la procédure : comment faire pour obtenir réparation de son préjudice parfois extrêmement lourd (handicap, décès, préjudice moral, maladie nosocomiale…) ?
L’accident médical reconnu par le droit
Tout acte de soin actif ou passif, de prévention et de diagnostic peut entraîner un accident médical, tel que défini par la loi du 4 mars 2002 (dite loi « KOUCHNER » renforçant les droits des patients), et entraîner l’engagement d’une procédure visant à permettre une indemnisation ou sanction du professionnel de santé, à condition que l’acte médical responsable soit postérieur au 4 septembre 2001. En effet, ce texte prévoit un principe de responsabilité sans faute du professionnel ou de l’entité de santé (laboratoire…) applicable aux accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales ou dommages imputables à des recherches médicales (comme l’aléa thérapeutique), ayant entraîné un dommage anormal en comparaison de l’évolution prévisible et normale de l’état de santé, imputable directement à l’intervention du professionnel et ayant entraîné un préjudice d’une gravité certaine (arrêt de travail, inaptitude professionnel, handicap…). Notons enfin que le délai de prescription est de 10 ans, et court à compter de la consolidation de l’état de santé, ou de la majorité lorsque l’erreur médicale est survenue durant la minorité de l’enfant.
Quel recours et quelle procédure ?
Le recours peut concerner une indemnisation du préjudice subi, ou encore une sanction du professionnel (voire une modification des pratiques médicales)
Il convient de saisir par courrier recommandé avec accusé de réception la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et infections nosocomiales (CRCI), créées par décret du 3 mai 2002 conformément aux articles L 1142-6 et L1143-1 du Code de santé publique. Une médiation est alors mise en place afin de tenter de parvenir à une transaction amiable de la part du professionnel ou de son assureur, ou de la part de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) dans le cadre d’un accident médical lié à l’aléa thérapeutique.
Par ailleurs, si l’erreur médicale implique un professionnel de santé exerçant en libéral ou un établissement privé, le litige peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance (ou d’instance lorsque le préjudice est estimé inférieur à 10 000€). Lorsqu’elle implique un établissement public, seul le tribunal administratif est alors compétent. Il convient de joindre un rapport d’expertise médicale à la saisine effectuée par la victime, expertise médicale qui reste à la charge du lésé qui doit en outre recourir obligatoirement à un avocat.
![]()

Le CDD : Ce qu’il faut savoir
Ordonnances macron : Quels changements pour le contrat à durée déterminée (CDD) ?
La réforme du Code du travail voulue par le Président de la République Emmanuel MACRON s’est traduite par la présentation le 31 août 2017 de 5 ordonnances, présentées le 22 septembre suivant en Conseil des Ministres. Parmi ces 5 ordonnances, la 3e relative à la « prévisibilité et sécurisation des relations de travail » vise à réformer le régime légal des contrats de travail temporaire ainsi qu’aux CDD (contrats à durée déterminée) conclus après leur publication (soit après le 23 septembre 2017), et en particulier concernant le rôle renforcé pour la négociation au niveau des branches sociales en ce qui concerne sa durée, son renouvellement, son délai de carence et les règles applicables en matière de requalification en CDI (contrat à durée indéterminée). L’orientation donnée par ces ordonnances est donc clairement celle de la primauté accordée à la négociation au niveau des entreprises ou des branches.
1. Le pouvoir conféré aux partenaires sociaux de fixer la durée totale du CDD
L’article 1242-8 du Code du travail prévoyait jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances MACRON que le CDD ne pouvait « excéder dix-huit mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements ». Or, ce texte modifié par l’article 25 de l’ordonnance susvisée prévoit désormais que la durée maximale du CDD peut être déterminée librement et sans plafond légal dans le cadre d’une négociation conventionnelle entre partenaires sociaux, à l’exception des CDD visant à recruter un ingénieur ou cadre en vue de la réalisation d’un projet défini visé par l’article L1242-2 6° du Code du travail, ainsi qu’aux contrats conclus pour favoriser le recrutement de personnes en situation de chômage ou en complément de formation professionnelle.
Cette mesure vise clairement à encourager les entreprises à recruter à moindre risque afin de créer des postes « à tout prix ». Autrement dit, le choix politique effectué est celui de privilégier l’emploi, même précaire sur du moyen/long terme, par rapport au chômage. Il conviendra tout de même de suivre l’évolution de la jurisprudence avec intérêt à ce sujet, puisque la chambre sociale de la Cour de cassation considère actuellement et de manière constante, que le CDD ne peut « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En l’absence de durée maximale fixée conventionnellement au niveau de la branche, la durée légale de 18 mois reste tout de même applicable (renouvellement compris), sauf pour certains cas particuliers, comme notamment le contrat à durée déterminée conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un nouveau salarié, pour des travaux urgents imposés par le principe de sécurité ou de précaution, le départ définitif d’un salarié, ou encore une variation exceptionnelle du volume d’activité.
2. La détermination du nombre maximal de renouvellements par accords de branches
Depuis 2015, un CDD pouvait être renouvelé deux fois (une seule fois auparavant) dans la limite d’une durée totale de 18 mois. Désormais, le principe légal fixé par l’article 26 devient celui de la négociation ou de l’accord de branche comme déterminé par l’article L1243-13 du Code du travail modifié, donnant pouvoir aux partenaires sociaux pour déterminer le nombre maximal de renouvellements, sans plafond fixé par les textes légaux. A défaut d’accord conventionnel et seulement dans ce cas, le principe restera celui d’une limitation à deux renouvellements consécutifs du CDD.
3. La négociabilité de la durée du délai de carence
Concernant les modalités et la durée du délai de carence, les ordonnances viennent fixer le même principe de négociation entre partenaires sociaux, puisque les conventions de branche ont désormais pouvoir de fixer les règles applicables (article 27 de l’ordonnance).
Toutefois, ce principe est à nuancer par le fait que l’article 27-1 de cette même ordonnance précise que ce délai de carence doit impérativement être déterminé en jours ouvrés : « les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement ».
Ici également, à défaut d’accord négocié par les partenaires sociaux, l’article L1244-3-1 du Code du travail reste pleinement applicable, soit un délai de carence fixé à 1/3 du contrat lorsque le CDD (renouvellements inclus) est d’une durée inférieure à 14 jours, ½ en cas contraire.
Enfin, il convient de souligner que les conventions de branche pourront déterminer des situations pour lesquelles le délai de carence n’est pas applicable.
4. Obligation de transmission de l’employer : fin de la requalification automatique en CDI
Il ressortait des dispositions de l’article L1242-12 et L1242-13 du Code du travail ainsi que de la jurisprudence constante (par exemple : Cass. Soc. 17/06/2005, pourvoi 03-42.596), que l’employeur doit dans les deux jours ouvrables suivant la signature du contrat à durée déterminée transmettre le contrat par écrit et mentionnant le motif précis de signature. La sanction en cas de non respect de ces dispositions était celui de la requalification de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI).
Désormais et depuis l’entrée en vigueur des ordonnances, cette absence de transmission dans le délai légal de 2 jours ne constitue plus à elle seule un motif de requalification (article 4-V et VI de l’ordonnance numéro 3), remettant ainsi en cause la jurisprudence établie. Mais la situation n’en demeure pas moins floue, et il est à prévoir un contentieux foisonnant sur lequel les juges devront statuer dans les mois à venir.
Seule demeure certain dans ce cas le maintien d’une indemnité au profit du salarié, à la charge de l’employer, et qui est plafonnée à un mois de salaire. Une indemnité qu’il convient de distinguer de celle prévue par l’article L1245-2 du Code du travail (indemnité de requalification). Il est à noter d’ailleurs que l’articulation de ces deux indemnités, et notamment les règles en matière de cumul de celles-ci, sont loin d’être claires…
![]()
