
Circulaire du 24 avril 2019 encadrant les régimes matrimoniaux et partenariats
Le 24 avril 2019, une circulaire est venue présenter les régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés dans la sphère européenne. Zoom avec Ake Avocats
Régimes matrimoniaux et partenariats : nouvelle circulaire du 24 avril 2019
Le 24 avril 2019, le ministère de la Justice a émis une circulaire présentant les règlements européens n° 2016/1103 et 2016/1104 visant à renforcer la coopération en matière de régimes matrimoniaux et de partenariats enregistrés. Ainsi, cette circulaire apporte des éclairages sur les règles du régime primaire et élargit notamment la possibilité de choisir son régime conventionnel. Quelles sont les nouveautés apportées par cette circulaire ? Réponse avec Ake Avocats.
Une présentation des règlements européens sur les régimes matrimoniaux
La circulaire du 24 avril 2019 vise à présenter les deux règlements européens entrés en application le 29 janvier 2019 (n° 2016/1103 et n° 2016/1104) et qui concernent les régimes matrimoniaux présentant un lien avec l’étranger. Ces règlements visent plus particulièrement tous les couples mariés ou unis par un partenariat célébré dans un Etat membre de l’Union européenne.
Ainsi, la circulaire vise à présenter de manière exhaustive les règles encadrant l’acceptation et la reconnaissance juridique de ces actes conclus à l’étranger. Ces règlements ne concernent que le mariage et le partenariat, sans viser la succession du partenaire ou du conjoint. Sont également uniquement concernées toutes les procédures de mariages et de PACS depuis le 29 janvier 2019. Ainsi, toutes celles ayant eu lieu avant cette date ne sont pas concernées par la circulaire et les règlements.
Les Etats membres de l’Union européenne ayant choisi de participer à cette coopération renforcée appliquent la circulaire, ce qui permet aux couples ayant conclu un mariage ou un PACS à l’étranger de voir reconnaître plus facilement leur statut en France.
Le choix de la loi applicable aux époux et aux partenaires
La circulaire précise que les partenaires enregistrés disposent désormais de la liberté de choisir la loi applicable à leur partenariat. Cela n’était pas le cas précédemment, le Code civil imposant d’appliquer les dispositions de l’Etat où l’autorité a procédé à l’enregistrement du PACS.
En outre, la circulaire estime qu’il est désormais possible pour le couple marié ou pacsé de choisir entre se soumettre au régime légal ou bien à un régime conventionnel. Concrètement, les époux peuvent décider de choisir un régime conventionnel du droit français plutôt que d’être soumis à la loi étrangère du lieu où a été célébrée leur union.
Il est à noter que ces décisions devront être librement acceptées et reconnues dans tous les Etats qui participent à la coopération renforcée.
Une circulaire accompagnée de 4 fiches pratiques
La circulaire comporte 4 fiches destinées à comprendre le champ d’application des deux règlements, à fixer la compétence des autorités, à déterminer la loi applicable et à renforcer les règles applicables à l’acceptation, la reconnaissance et la force exécutoire des décisions et actes authentiques.
Véritables outils pratiques, ces fiches techniques sont conçues de manière pédagogique, dans un souci de bonne compréhension.
- la première présente les champs d’application des 2 règlements européens et permet leur articulation avec la Convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux
- la seconde vise la compétence des Etats et des autorités
- la troisième fiche concerne plus particulièrement la loi applicable aux mariages et partenariats enregistrés, en droit international. En effet, elle permet de régler certains conflits de lois lorsque le mariage ou le PACS est conclu à l’étranger et que les époux ou partenaires souhaitent par la suite faire reconnaître l’acte en France
- la quatrième présente le processus de reconnaissance des actes et les déclarations qui acquièrent force exécutoire.
À lire : Zoom sur l’exonération fiscale des heures supplémentaires
![]()

Refus de travail le dimanche et licenciement pour faute
Vous avez refusé de travailler le dimanche et vous vous demandez si cela constitue une cause légitime de licenciement pour faute ? Eclairage avec Ake Avocats
Le refus de travailler le dimanche est-il une cause légitime de licenciement pour faute ?
 La loi encadre strictement le travail le dimanche, notamment afin d’éviter tout abus de la part des employeurs. Les évolutions récentes ont néanmoins ouvert la possibilité pour les commerces d’ouvrir le dimanche, avec les conséquences que cela emporte. Si la presse fait état de nombreux cas de licenciements de salariés pour faute grave du fait de leur refus de travailler un dimanche, qu’en est-il juridiquement ? Un employeur peut-il contraindre ses salariés à travailler un dimanche et est-il dans son droit de les licencier pour faute grave en cas de refus ? Ake Avocats vous donne tous les éléments de réponse dans cet article.
La loi encadre strictement le travail le dimanche, notamment afin d’éviter tout abus de la part des employeurs. Les évolutions récentes ont néanmoins ouvert la possibilité pour les commerces d’ouvrir le dimanche, avec les conséquences que cela emporte. Si la presse fait état de nombreux cas de licenciements de salariés pour faute grave du fait de leur refus de travailler un dimanche, qu’en est-il juridiquement ? Un employeur peut-il contraindre ses salariés à travailler un dimanche et est-il dans son droit de les licencier pour faute grave en cas de refus ? Ake Avocats vous donne tous les éléments de réponse dans cet article.
Un jour de repos par semaine soumis à dérogations
La loi précise que l’employeur doit obligatoirement accorder un jour de repos hebdomadaire à ses salariés. Si ce dernier a en principe lieu le dimanche, il en va différemment selon les situations. La loi Macron de 2015 a en effet revu les dérogations entourant le jour de repos hebdomadaire, afin de permettre aux commerces d’être ouverts plus facilement le dimanche. On distingue ainsi plusieurs dérogations :
- les commerces situés dans des zones touristiques ou commerciales, où le passage est important et continu tout au long de la journée. Cela concerne également les zones commerçantes situées dans les gares
- les dérogations convenues par le maire ou le préfet afin d’éviter un préjudice et allant dans le sens normal du fonctionnement de l’entreprise
- les dérogations prévues dans les contrats de travail. On parle alors de dérogations conventionnelles
- les dérogations de droit qui sont liées aux besoins du public. Il s’agit par exemple des hôpitaux, entreprises de presse, établissements de santé et commerces de détail alimentaire.
Dans le cadre des dérogations de droit, les employeurs ne sont pas tenus de demander au préalable l’autorisation à leurs salariés pour travailler le dimanche. Ces derniers ne reçoivent pas de contrepartie, hormis s’ils travaillent dans un magasin dont la superficie excède 400 m². Pour les dérogations à l’initiative des autorités, dans les commerces de détail non alimentaires, le travail dominical repose sur l’accord écrit du salarié.
Principe de base : accord préalable du salarié
Le Code du travail est clair sur la question : la base de tout travail dominical repose sur l’accord exprès du salarié. Ainsi, l’article L. 3132-25-4 du Code du travail prévoit que seuls les salariés ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Ainsi, s’ils refusent, cela ne peut en principe pas constituer un motif légitime de licenciement de la part de l’employeur. Cependant, la loi ne prévoit aucun droit particulier pour le salarié de refuser le travail le dimanche. Ainsi, dans les situations où la loi prévoit des dérogations (le cas des hôpitaux par exemple), le refus du salarié de travailler le dimanche peut effectivement constituer une faute de sa part, ce qui peut aller jusqu’à son licenciement.
Que peut-on donc en déduire ? Tout dépend en réalité du contrat de travail. Si ce dernier ne prévoit pas que le salarié est contraint de travailler le dimanche, l’employeur n’est pas en droit de lui imposer le travail dominical puisque cela constitue une modification unilatérale du contrat de travail. Vous rencontrez un litige avec votre employeur ? Cabinet d’avocats en droit du travail, Ake Avocats vous accompagne pour défendre au mieux vos intérêts.
À lire : Zoom sur l’exonération fiscale des heures supplémentaires
![]()

Accident du travail : conséquences de l’inaptitude sur le salarié
Si un salarié est déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, cela entraîne de nombreuses conséquences. Quelles sont-elles ? Eclairage avec Ake Avocats
Conséquences de l’inaptitude suite à un accident du travail
La loi Travail en date du 8 août 2016 a profondément transformé la procédure d’inaptitude. A la suite d’un accident du travail, un salarié peut être déclaré inapte par le médecin du travail. Consécutive à un événement de nature professionnelle, cette inaptitude entraîne des conséquences importantes, que ce soit du côté de l’entreprise comme du salarié lui-même. Quelles sont les incidences de l’inaptitude d’un salarié à la suite d’un accident du travail ? Ake Avocats vous éclaire dans cet article.
Accident du travail et inaptitude professionnelle : le reclassement du salarié
Une fois que le salarié est considéré comme inapte par la médecine du travail à la suite d’un accident du travail (l’inaptitude est donc d’origine professionnelle), son employeur est tenu de chercher activement une solution de reclassement. Ce reclassement doit prendre en considération les préconisations rendues par le médecin du travail. Si cela est nécessaire, l’employeur analyse l’adaptation des aménagements en temps de travail ainsi que les adaptations du poste de travail à l’état de santé du salarié inapte.
Si l’entreprise comporte au moins 11 salariés, l’employeur consulte le Comité social et économique (CSE) sur cette question et sur l’opportunité de trouver un poste adapté de reclassement. Si l’employeur licencie le salarié, ce dernier pourra agir en justice afin de requalifier ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il faudra alors saisir la juridiction prud’homale compétente pour ces questions.
Néanmoins, le reclassement ne s’applique pas si l’avis d’inaptitude précise que l’état de santé du salarié inapte ne permet pas un reclassement dans un autre emploi ou bien que le maintien du salarié pourrait être préjudiciable à son état de santé.
Reclassement impossible : que se passe-t-il pour le salarié ?
Il peut donc arriver en pratique que le reclassement soit impossible. Si cela est le cas, le salarié est informé le plus rapidement possible par écrit. Si cette impossibilité de reclassement est consécutive à un refus du salarié, son employeur est alors en droit de le licencier pour inaptitude médicale de nature professionnelle et impossibilité de reclassement.
Dans tous les cas, sachez que votre salaire vous sera dû par l’employeur jusqu’à la réception de la lettre de licenciement par courrier recommandé avec avis de réception, ou bien sa présentation en main propre. La Cour de cassation se base sur la date de présentation du courrier de notification et jamais sur la date de son envoi. C’est cette date qui fait foi pour fixer la date définitive de rupture du contrat de travail de l’employé inapte. Si vous êtes licencié pour inaptitude professionnelle, sachez également que votre employeur sera tout de même tenu de vous verser une indemnité compensatrice de préavis.
Si cette inaptitude est d’ordre professionnel, ce qui est le cas si elle est consécutive à un accident de travail, l’employeur vous verse aussi une indemnité spéciale de licenciement dont le montant est au moins égal au double de l’indemnité légale de licenciement.
Vous avez des interrogations sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte après un accident de travail ou vous souhaitez faire valoir vos droits en justice en tant que salarié inapte ? L’intervention d’un avocat spécialisé en droit du travail est indispensable pour défendre au mieux vos intérêts.
À lire : Focus sur la déjudiciarisation en droit du travail
![]()

Récidive légale des personnes physiques et peines applicables
Quelles sont les différentes peines applicables juridiquement pour les individus en situation de récidive légale ? Réponse avec Ake Avocats
Personnes physiques : récidive légale et peines applicables
En France, la récidive légale vise toute situation pénale dans laquelle une personne déjà condamnée commet à nouveau une infraction pénale. La seconde condamnation pénale est donc en principe plus lourde que la précédente. Qu’est-ce que la récidive légale en droit français et quelles sont les différentes peines applicables pour les personnes physiques ? Ake Avocats vous répond dans cet article.
Récidive légale des personnes physiques : définition et contours
Un état de récidive légale concerne toute nouvelle commission d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. La seconde condamnation est alors susceptible d’être plus lourde que la précédente. Depuis l’instauration de la loi du 15 août 2014 (loi n° 2014-896 relative à l’individualisation des peines), il n’y a plus de peine minimum en situation de récidive légale des personnes physiques. Mises en place en 2007 pour améliorer la lutte contre la récidive, ces peines planchers ont été supprimées en 2014. On distingue la récidive temporaire, perpétuelle et contraventionnelle. Cette récidive peut être générale (si elle concerne n’importe quelle infraction) ou bien spéciale (s’il s’agit d’un même délit ou crime). Par exemple, si un individu condamné pour une atteinte sexuelle commet une agression sexuelle, ces deux délits seront considérés comme faisant partie de la même infraction. Il en va différemment si l’individu a réitéré en commettant un viol, cette infraction étant cette fois-ci un crime et non plus un délit.
Les différents types de récidives légales
On distingue différentes situations de récidives légales. En soi, la récidive constitue une circonstance aggravante qui vient alourdir la nouvelle peine prononcée. La récidive est considérée comme générale puisqu’elle s’applique d’elle-même à une infraction, à l’opposé des circonstances aggravantes spéciales. Par exemple, un viol est aggravé s’il est commis en réunion, ce qui est prévu par le législateur dans le Code pénal. Au contraire, la récidive n’a pas à être prévue par le législateur puisqu’elle concerne toutes les infractions.
- si la récidive est générale, il n’est pas nécessaire que le comportement infractionnaire soit de la même nature que celui qui a donné lieu à la première condamnation
- si la récidive est spéciale, il est au contraire nécessaire que le comportement illégal soit à l’identique du premier comportement ayant donné lieu à une condamnation
- les notions de récidives perpétuelle et temporaire renvoient directement à une notion de temps. Elle est perpétuelle sans distinction du temps écoulé entre les deux infractions (la première et celle en récidive légale) tandis qu’elle est temporaire si le nouvel acte intervient dans un délai maximum déterminé par la législation.
L’état de récidive légale contraventionnelle
La récidive légale concerne également la commission d’infractions contraventionnelles. Ainsi, si une personne commet une contravention de 5e classe et qu’il commet la même contravention en état de récidive légale dans un délai d’un an, le montant maximum de la peine d’amende qu’il encourt est susceptible d’être doublée. Cela doit néanmoins être prévu par le Code pénal réprimant cette infraction, et plus particulièrement par l’article 132-11 du Code pénal. Si la loi prévoit que la réitération d’une contravention est constitutive d’un délit, le délai pour qu’il y ait récidive légale est alors porté à 3 ans et non plus à 1 an. Vous avez commis une infraction en état de récidive légale ou êtes victimes d’une telle infraction ? Il est nécessaire de vous entourer des conseils d’un avocat spécialisé en droit pénal.
![]()
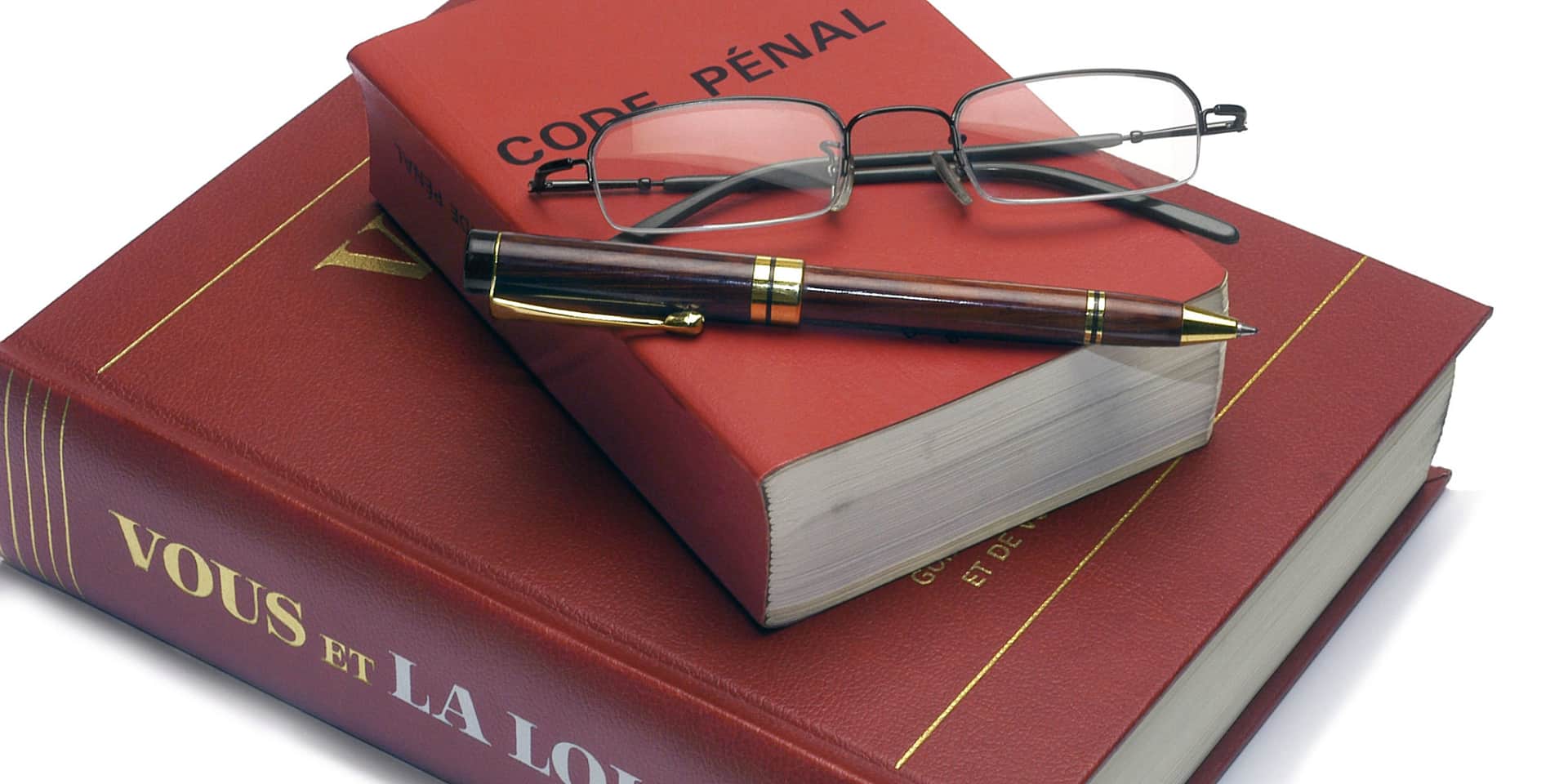
La nouvelle loi de réforme de la justice
Promulguée le 23 mars 2019, la loi de réforme pour la justice apporte des modifications en matière civile et pénale. Zoom avec Ake Avocats
Nouvelle loi de réforme de la justice : les nouveautés en matière civile et pénale
La loi 2018-2022 de réforme pour la justice et la loi organique a été promulguée définitivement le 23 mars 2019 après la saisine préalable du Conseil Constitutionnel.
a été promulguée définitivement le 23 mars 2019 après la saisine préalable du Conseil Constitutionnel.
Promettant d’apporter davantage de lisibilité, de simplicité et de rapidité, ce nouveau texte est destiné à offrir de meilleures solutions au justiciable. La nouvelle loi de réforme de la justice concerne tant la simplification de la procédure civile que l’introduction de nouveautés en matière pénale. Ake Avocats vous propose un tour d’horizon de ces nouveautés.
Eléments d’inspiration de cette réforme
En 1998, sortait le rapport Coulon par lequel la crise de la justice prenait tout son sens. Depuis lors, le Gouvernement s’est donné comme objectif d’adapter au maximum la justice aux évolutions sociétales. En 2008, un autre rapport (le rapport Guinchard) évoquait la nécessite de traiter les contentieux les plus techniques de manière particulièrement spécialisée tout en proposant aux justiciables une justice plus transparente, lisible et facile d’accès. S’en suivra en 2013 le rapport rendu par Pierre Delmas-Goyon qui pousse alors à s’interroger sur le sens de l’intervention du juge et sur l’étendue de ses prérogatives. C’est dans ce contexte que la loi de réforme de 2019 a vu le jour.
Les nouveautés de cette réforme en matière pénale
Dans le domaine pénal, cette réforme entraîne des nouveautés qui auront une incidence certaine sur les justiciables :
- il sera possible de déposer une plainte directement en ligne, ce qui est un gain évident de temps et de praticité
- un parquet national antiterroriste sera créé
- l’organisation judiciaire va être repensée et le justiciable aura désormais accès à un tribunal judiciaire unique
- les peines seront repensées, notamment au regard de la question d’échelle et de proportionnalité entre la peine prononcée et l’acte commis. L’objectif affiché est de redonner du sens à la peine et de l’efficacité réelle
- 15 000 places de prison seront créées et 7 000 seront livrées en 2022. L’immobilier pénitentiaire doit aussi être repensé pour faire face à une réalité aujourd’hui bien souvent trop contraignante dans le milieu pénitentiaire.
Une simplification de la procédure civile
Dans le cadre de la procédure civile, les changements apportés par cette nouvelle loi de réforme de la justice sont conséquents :
- une plus grande rapidité et de meilleures garanties dans le cadre du divorce contentieux
- le système entourant les majeurs protégés fera l’objet d’une réforme. Ces derniers auront plus de droits, pourront se marier et se pacser sans autorisation préalable. L’office du juge sera recentré sur la protection et la confiance envers les familles revalorisée
- une juridiction nationale pour les injonctions de payer sera créée, notamment de sorte à désengorger les tribunaux d’instance et de grande instance. Y officieront des greffiers et des juges spécialisés dans ce domaine.
- si les parties sont d’accord, les jugements pourront être rendus sans audience. Pour les litiges mineurs, la procédure sera entièrement numérique, notamment dans un souci d’efficacité et de rapidité.
- les juges auront un pouvoir plus important pour adjoindre les parties d’avoir recours à un médiateur quand ils considèrent que son intervention pourra apporter une meilleure solution au litige. L’objectif est de de promouvoir cette forme de règlement amiable des litiges trop souvent laissée de côté dans les juridictions
- création pour la toute première fois d’un système de certification unique pour les plateformes qui proposent aux consommateurs un service d’arbitrage, de conciliation ou de médiation en ligne.
![]()

Chute dans un magasin et droit à indemnisation
Quels sont les contours du droit à indemnisation d’un client qui chute dans un magasin ? Ake Avocats vous informe sur ce droit dans cet article
Chute dans un magasin : quel est votre droit à indemnisation ?
Nombreux sont ceux qui chutent un jour dans un magasin. Depuis 2017, les règles encadrant la charge de la preuve ont été modifiées, en faveur d’une meilleure indemnisation des clients victimes. Quel est votre droit à indemnisation si vous chutez dans un magasin et comment obtenir réparation dans les meilleures conditions ? Zoom dans cet article avec Ake Avocats.
Principe : obligation de sécurité de résultat du magasin
 La législation est stricte sur la question de la responsabilité du magasin quant à la chute de ses clients. Ainsi, ce dernier est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui se base sur le principe de la sécurité générale des produits et services. Cette obligation découle de l’article L. 421-3 du Code de la consommation qui considère que les produits et les services fournis doivent, dans le cadre d’une utilisation normale, présenter le niveau de sécurité normalement et légitimement attendu et ne jamais porter une atteinte à la santé des personnes.
La législation est stricte sur la question de la responsabilité du magasin quant à la chute de ses clients. Ainsi, ce dernier est tenu à une obligation de sécurité de résultat, qui se base sur le principe de la sécurité générale des produits et services. Cette obligation découle de l’article L. 421-3 du Code de la consommation qui considère que les produits et les services fournis doivent, dans le cadre d’une utilisation normale, présenter le niveau de sécurité normalement et légitimement attendu et ne jamais porter une atteinte à la santé des personnes.
La Cour de cassation a d’ailleurs pu à de nombreuses reprises réaffirmer cette position stricte, en faisant application du code de la consommation de manière littérale. Depuis 2017, le client qui chute dans un magasin n’a plus à utiliser la responsabilité civile du fait des choses, prévue par l’article 1242 du Code civil. Il peut désormais faire jouer la responsabilité de plein droit dont les exploitants des lieux de vente sont soumis.
Cela modifie donc forcément la charge de la preuve dans la mesure où le client qui chute à l’intérieur d’un magasin n’a plus à démontrer que la chose inerte sur laquelle il est tombé était en mauvais état ou avait une position anormale. Cela signifie donc que le client victime de la chute n’aura plus besoin de démontrer la commission d’une faute de la part de l’exploitant du magasin.
Comment faire pour obtenir une indemnisation en cas de chute ?
Vous avez été victime d’une chute dans un magasin et souhaitez obtenir une indemnisation dans le cadre de l’application de la loi ? Il est préférable de vous adresser à un avocat spécialisé pour faire valoir vos droits. Pour obtenir indemnisation en cas de chute, il vous faut réaliser une déclaration d’accident en compagnie du gérant du magasin dans lequel vous avez chuté.
La déclaration est à produire en double exemplaire et doit préciser avec le plus de détails possibles les circonstances ayant induit l’incident. Nous vous conseillons de conserver dans un lieu sûr tous les justificatifs qui pourront permettre d’établir avec le plus de précisions possibles votre préjudice et ainsi d’agir à l’encontre de l’établissement.
Ces justificatifs peuvent être divers : des témoignages, des rapports d’expertise ou encore des certificats médicaux. De cette manière, l’établissement pourra faire actionner son assurance qui procèdera à votre indemnisation. Cependant, il arrive parfois que l’établissement n’ait pas d’assurance professionnelle ou bien qu’il refuse tout simplement de vous indemniser. Dans ce cas, il vous faudra intenter une action en justice afin d’obtenir une réparation de votre préjudice. Si le montant est inférieur à 10 000 €, le tribunal d’instance se chargera de votre dossier. Si la somme excède ce montant, la juridiction compétente sera le tribunal de grande instance.
![]()

Saisie sur salaire : hausse de la fraction insaisissable
Depuis le 1er avril 2019, la fraction insaisissable du salaire augmente de 0,3 %. Quelle est l’incidence de cette hausse pour les salariés ? Zoom sur cette mesure
Hausse de la fraction insaisissable dans le cadre d’une saisie sur salaire
Au 1er avril 2019, le revenu de solidarité active (RSA) augmente de 0,3 %, ce qui a pour incidence de provoquer une hausse de la fraction insaisissable du revenu dans le cadre d’une saisie sur salaire. Qu’est-ce que cette nouveauté législative et qu’implique-t-elle pour tous les salariés à compter de 2019 ?
Qu’est-ce que le salaire insaisissable ?
Qu’appelle-t-on salaire insaisissable ? Dans certaines situations, il peut arriver que le salarié ait des dettes qu’il n’a pas honorées. Dans ce cas, son employeur obtient au préalable une autorisation de la part du juge d’instance, en vue d’une saisie-attribution de la somme correspondant à la dette de travail due par le salarié. Cet employeur est en effet en droit de demander une saisie sur rémunérations. Cette possibilité relève des articles L3252-1 à L3252-13 du Code du travail. Si l’employeur peut effectivement saisir une partie des rémunérations versées à son salarié, il est pour autant tenu de lui laisser une partie de sa rémunération. Le principe est que chaque année, les parts saisissables de la rémunération font l’objet d’une réévaluation, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. En outre, l’article L. 3252-3 du Code du travail prévoit que l’employeur, alors appelé « tiers-saisi » est dans l’obligation de laisser au salarié une somme égale au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, peu importe les charges de famille incombant au salarié.
Une hausse concomitante à celle du RSA
A compter du 1er avril 2019, le revenu de solidarité active passe de 550,93 € à 559,74 € par mois pour une personne résidant seule. Concomitamment à cette hausse, le montant du revenu insaisissable augmente, passant alors à 559,74 €. Que cela signifie-t-il ? Concrètement, cela signifie que dans le cadre d’une saisie sur salaire, vous disposerez toujours d’un revenu mensuel de 559,74 € au minimum.
Une saisie qui respecte certaines règles de priorité
Si le salarié doit faire face à plusieurs procédures et qu’il est débiteur de plusieurs sommes différentes, l’employeur est tenu de respecter un certain ordre de saisie :
- dans un premier temps, priorité est donnée au versement de la pension alimentaire au bénéfice du salarié redevable
- ensuite, les impôts sont prioritaires sur l’employeur, en matière de dettes fiscales
- en troisième position, la saisie sur salaire peut avoir lieu.
Une fois que la saisie est réalisée, mention en est faite sur le bulletin de paie, entre le salaire net et le « net à payer », plus particulièrement dans une rubrique spéciale nommée « Retenue sur salaire ». Un tel prélèvement sur le salaire ne diminue pas en principe le revenu imposable.
Si le salarié qui est redevable d’une dette sur salaire se retrouve au chômage ou bien après un licenciement, son allocation ou sa pension sera saisie de la même manière et dans le respect des mêmes conditions que son dernier salaire.
Vous avez besoin de plus d’informations sur le salaire insaisissable, vous rencontrez une difficulté ou un litige avec votre employeur dans le cadre de la saisie attribution ? Ake Avocats intervient en matière de droit du travail pour vous accompagner tout au long de vos démarches.
![]()

Zoom sur l’exonération fiscale des heures supplémentaires
Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires réalisées par les salariés sont défiscalisées et sont exonérées de cotisations sociales
Exonération d’impôt des heures supplémentaires : la nouveauté 2019
Les règles entourant la déclaration d’heures complémentaires et supplémentaires ont été modifiées par l’impulsion de l’entrée en vigueur de la loi relative aux mesures d’urgence économiques et sociales. Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt, dans une certaine limite et à certaines conditions cependant. Quelles sont les règles encadrant cette exonération d’impôt ? Tour d’horizon sur la situation en 2019.
Zoom sur le mode de rémunération des heures supplémentaires
Comment sont payées les heures supplémentaires ? Que prévoit la législation actuelle sur cette question ? Le principe est que toutes les heures réalisées en supplément des heures légales de travail font l’objet d’une majoration par rapport au salaire brut de base.
Autrement dit, les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération supérieure aux heures normales mais induisent davantage de cotisations à payer pour l’employeur. D’où l’intérêt de ces nouvelles règles qui viennent défiscaliser ces heures et les exonérer de cotisations sociales.
En fonction de l’accord collectif dans l’entreprise, la majoration des heures supplémentaires de travail varie. Elle peut être de 25 % ou de 50 %, ou bien différemment. Avec la nouvelle loi du Gouvernement Macron, les salariés gagneront concrètement plus s’ils travaillent plus.
Une exonération fiscale des heures supplémentaires
Le principe est qu’à compter du 1er janvier 2019, tous les salariés n’ont plus à déclarer fiscalement les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Néanmoins, si ces heures sont bien défiscalisées, elles n’en restent pas moins prises en considération dans le calcul du revenu fiscal de référence de chaque salarié.
Quelles sont les rémunérations visées par ces nouvelles règles ? Toutes les heures réalisées ne sont pas concernées. Il est donc nécessaire de cerner celles qui peuvent effectivement donner lieu à une exonération d’impôt :
- les heures supplémentaires entendues classiquement, autrement dit toutes les heures qui dépassent la durée légale de travail hebdomadaire
- pour tous les salariés embauchés dans le cadre d’un forfait calculé en heures annuelles : les heures concernées sont celles qui vont au-delà de la 1607e heure
- pour les salariés qui sont embauchés en forfait annuel compté en jours, les heures défiscalisées sont celles qui vont au-delà du 218e jour de travail.
De la même manière sachez que ces heures supplémentaires sont défiscalisées dans le respect d’un plafond de revenus, fixé à 5 000 € chaque année. Ainsi, si la rémunération excède 5 000 €, l’excédent devra obligatoirement être déclaré au titre de l’impôt sur le revenu.
Exonération des cotisations sociales
Dans le cadre de ces différentes heures supplémentaires, la législation a prévu une exonération des cotisations sociales d’assurance veuvage et d’assurance vieillesse, dans une limite fixée à 11,31 %. Cette mesure découle du décret en date du 24 janvier 2019 (décret n° 2019-40).
L’intérêt d’une telle mesure est de permettre aux salariés de pouvoir réaliser des heures complémentaires en augmentant leur pouvoir d’achat tout en permettant aux entreprises de ne pas payer de cotisations sociales trop élevées. Du côté des entreprises éligibles, ces dernières ont toujours pleinement droit aux réductions, à savoir la réduction Fillon et la déduction TEPA (déduction forfaitaire). Néanmoins, ces entreprises n’auront pas le droit à une réduction de charges patronales complémentaire.
![]()

Amnésie traumatique et viol sur mineur : délai de prescription
L’amnésie traumatique suspend-t-elle le délai de prescription dans le cas d’un viol sur mineur ? Éléments de réponse dans cet article.
Viol sur mineur : l’amnésie traumatique de la victime ne suspend pas la prescription
Par un arrêt rendu le 17 octobre 2018, la Cour de cassation est venue réaffirmer sa position quant au sort du délai de prescription dans le cadre d’un viol sur mineur. Etait posée la question de la possible suspension de cette prescription en cas d’amnésie traumatique de la victime. Qu’en est-il vraiment ? Réponse dans cet article.
L’amnésie traumatique n’est pas un obstacle insurmontable
La chambre criminelle devait répondre à la question de savoir si l’amnésie traumatique était constitutive d’un obstacle insurmontable et donc assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
En l’espèce, une jeune victime avait été violée à l’âge de dix ans. En 2000, soit dix ans après la majorité de la victime, la Chambre de l’instruction avait déclaré l’infraction comme prescrite, mettant en exergue que l’amnésie traumatique avancée par la victime ne pouvait constituer un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure et que de ce fait elle ne pouvait pas suspendre le délai de prescription.
La Cour de cassation considère que cette décision respecte les articles 9-1 et 9-3 du Code de procédure pénale en ce que ce motif ne peut pas être un argument permettant la suspension du délai de prescription.
Cette décision pose toutefois des questions. En effet, en espèce le viol avait été commis en 1982 contre un mineur, majeur en 1990. Si aujourd’hui le délai de prescription d’un viol est de 30 ans à compter de la majorité, cette nouvelle loi ne peut cependant pas venir remettre en cause une prescription acquise. Or, à l’époque des faits, la prescription d’un viol sur mineur n’était régie par aucune disposition spéciale, ce qui signifie que le délai de prescription était de 10 ans.
Ce n’est que par la suite, en vertu de la loi du 9 mars 2004, que le délai de prescription fut porté à 20 ans, puis 30 ans depuis la loi du 27 février 2017. Désormais, en vertu de l’article 9-3 du Code de procédure pénale, il serait possible de penser que les décisions futures pourraient évoluer favorablement dans le sens de l’assimilation d’une amnésie traumatique à un cas de force majeur suspensif de prescription.
Viol sur mineur et article 9-1 du Code de procédure pénale
Une autre zone d’ombre plane sur la décision rendue par la Cour de cassation. En effet, cette dernière se base notamment sur l’article 9-1 du Code de procédure pénale afin de motiver sa décision. Or, cet article date du 3 août 2018, bien loin de la date de commission des faits et de la prescription acquise en 2000.
En outre, l’article 9-1 de ce même Code a trait aux infractions occultes, ce qui ne semble pas être de circonstance ici.
L’infraction occulte y est définie comme étant une infraction qui ne peut être connue ni de l’autorité judiciaire ni de la victime en raison de ses éléments constitutifs. Or, le viol est une infraction qui, par définition, est connue de sa victime. L’amnésie traumatique ne découle évidemment pas de ces considérations.
Aujourd’hui, la question du report du délai de prescription pour cause d’amnésie traumatique revient sur le devant de la scène, de manière moins importante cependant en raison de l’allongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
![]()
