
Amnésie traumatique et viol sur mineur : délai de prescription
L’amnésie traumatique suspend-t-elle le délai de prescription dans le cas d’un viol sur mineur ? Éléments de réponse dans cet article.
Viol sur mineur : l’amnésie traumatique de la victime ne suspend pas la prescription
Par un arrêt rendu le 17 octobre 2018, la Cour de cassation est venue réaffirmer sa position quant au sort du délai de prescription dans le cadre d’un viol sur mineur. Etait posée la question de la possible suspension de cette prescription en cas d’amnésie traumatique de la victime. Qu’en est-il vraiment ? Réponse dans cet article.
L’amnésie traumatique n’est pas un obstacle insurmontable
La chambre criminelle devait répondre à la question de savoir si l’amnésie traumatique était constitutive d’un obstacle insurmontable et donc assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
En l’espèce, une jeune victime avait été violée à l’âge de dix ans. En 2000, soit dix ans après la majorité de la victime, la Chambre de l’instruction avait déclaré l’infraction comme prescrite, mettant en exergue que l’amnésie traumatique avancée par la victime ne pouvait constituer un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure et que de ce fait elle ne pouvait pas suspendre le délai de prescription.
La Cour de cassation considère que cette décision respecte les articles 9-1 et 9-3 du Code de procédure pénale en ce que ce motif ne peut pas être un argument permettant la suspension du délai de prescription.
Cette décision pose toutefois des questions. En effet, en espèce le viol avait été commis en 1982 contre un mineur, majeur en 1990. Si aujourd’hui le délai de prescription d’un viol est de 30 ans à compter de la majorité, cette nouvelle loi ne peut cependant pas venir remettre en cause une prescription acquise. Or, à l’époque des faits, la prescription d’un viol sur mineur n’était régie par aucune disposition spéciale, ce qui signifie que le délai de prescription était de 10 ans.
Ce n’est que par la suite, en vertu de la loi du 9 mars 2004, que le délai de prescription fut porté à 20 ans, puis 30 ans depuis la loi du 27 février 2017. Désormais, en vertu de l’article 9-3 du Code de procédure pénale, il serait possible de penser que les décisions futures pourraient évoluer favorablement dans le sens de l’assimilation d’une amnésie traumatique à un cas de force majeur suspensif de prescription.
Viol sur mineur et article 9-1 du Code de procédure pénale
Une autre zone d’ombre plane sur la décision rendue par la Cour de cassation. En effet, cette dernière se base notamment sur l’article 9-1 du Code de procédure pénale afin de motiver sa décision. Or, cet article date du 3 août 2018, bien loin de la date de commission des faits et de la prescription acquise en 2000.
En outre, l’article 9-1 de ce même Code a trait aux infractions occultes, ce qui ne semble pas être de circonstance ici.
L’infraction occulte y est définie comme étant une infraction qui ne peut être connue ni de l’autorité judiciaire ni de la victime en raison de ses éléments constitutifs. Or, le viol est une infraction qui, par définition, est connue de sa victime. L’amnésie traumatique ne découle évidemment pas de ces considérations.
Aujourd’hui, la question du report du délai de prescription pour cause d’amnésie traumatique revient sur le devant de la scène, de manière moins importante cependant en raison de l’allongement du délai de prescription à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs.
![]()
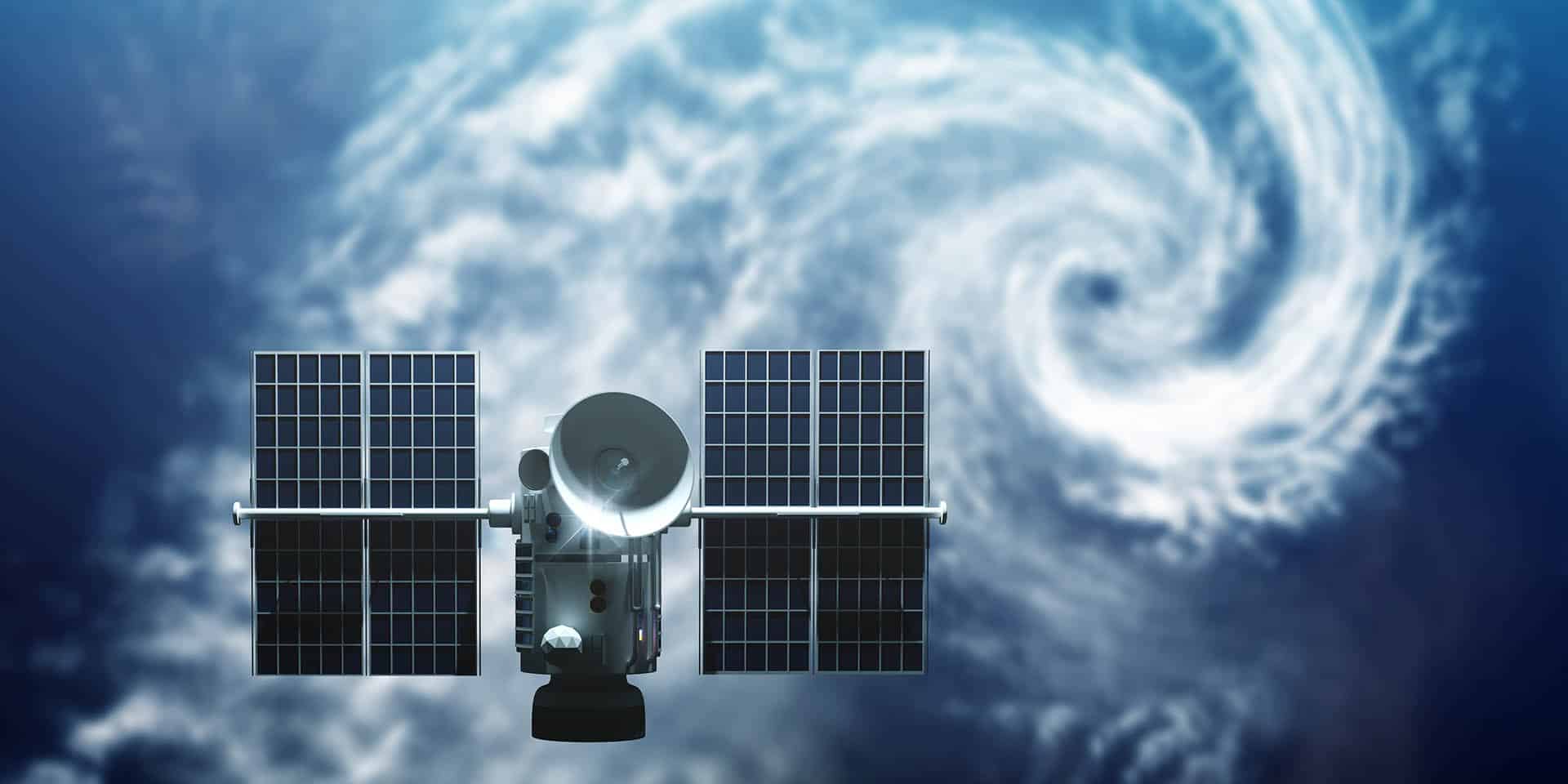
Alerte rouge cyclonique et jours chômés : quels sont vos droits ?
Alerte cyclonique : vos droits en matière de jours chômés
Lorsque les autorités lancent une alerte rouge cyclonique, le message est clair : « Protégez-vous ! ». Cela signifie donc que les entreprises doivent fermer boutique. La question se pose alors pour les salariés de savoir s’ils doivent être à leur poste ou bien si la consigne les dispense de cette obligation. Qu’en est-il vraiment des jours chômés durant cette période ? Réponse à cette question dans cet article.
Alerte cyclonique et interdiction préfectorale : suspension de la relation de travail
Dans le cadre d’une alerte de cette nature, les salariés se demandent si l’employeur peut prélever une journée de salaire dans le cas de leur absence de l’entreprise. En réalité, il n’existe pas de règle précisément définie en la matière. Si l’interdiction préfectorale indique bien que les entreprises doivent être fermées et que les salariés doivent être libérés, cela signifie que la relation de travail est suspendue. En pratique, ce communiqué de préfecture précise en substance qu’en ce qui concerne les mesures collectives, « tous les établissements publics et privés doivent être fermés, avec mise en œuvre de toutes les mesures de protection, en libérant les personnels ». On peut donc légitimement penser que l’employeur comme le salarié est délié de ses obligations telles que définies dans le contrat de travail. Le salarié ne sera pas présent dans l’entreprise et l’employeur ne sera pas tenu de verser la rémunération correspondante. Ainsi, il n’y a pas de règle en ce qui concerne une retenue partielle ou totale de la rémunération pendant ces jours chômés, sauf si une disposition conventionnelle est plus favorable au salarié. L’employeur est amené à prendre la décision qu’il juge la plus appropriée, ce dernier étant tenu à une obligation de santé et de sécurité des travailleurs au sein de l’entreprise. De son côté, le préfet est tout simplement le garant de la sécurité publique pour l’ensemble des citoyens. Sa décision a une valeur de consigne mais il appartient à chacun de prendre les dispositions qu’il juge nécessaires par rapport à sa responsabilité propre.
Les autres alternatives à la suspension de salaire
En cas d’alerte cyclonique, suivie ou pas d’une interdiction préfectorale, l’employeur peut donc suspendre la rémunération correspondant aux jours non travaillés par les salariés. Existe-t-il cependant des alternatives possibles à la suspension du salaire des salariés ? Il existe en la matière plusieurs solutions différentes pour pallier la ponction du salaire correspondant aux heures, voire aux journées non effectuées par les salariés. L’employeur pourrait par exemple proposer la récupération des heures non travaillées, au fur et à mesure, dans la limite d’une heure par jour sur 12 mois. Ce rattrapage des heures non travaillées à la suite de cet événement climatique doit être prévu par un accord collectif et adopté par l’employeur. Néanmoins, si aucun accord n’est passé en ce sens, le Code du travail prévoit tout de même des dispositions qui rendent possible la détermination d’une durée au cours de laquelle les heures récupérées peuvent être fixées. En cas de doute, la direction régionale, des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est disponible pour répondre aux questions du public.
![]()

Mouvement des Gilets jaunes et travail : comment gérer les jours chômés ?
Mouvement des Gilets jaunes : qu’en est-il des jours chômés ?
Le mouvement des Gilets Jaune a fortement perturbé l’économie de la France, et principalement les commerces situés en plein centre-ville. De nombreuses entreprises victimes de ces manifestations se sont posées la question de savoir comment gérer les retards et les absences des salariés pendant cette période, sans oublier la nécessité de fermer boutique, à l’instar de SFR qui avait dû fermer sa boutique des Champs-Elysées à Paris. Que prévoit le droit du travail en la matière ? Zoom avec Ake Avocats.
Nécessité de fermer boutique : obligation de rémunérer le salarié
Nombreux sont les commerces à avoir demandé expressément à leurs salariés de ne pas venir travailler pendant les jours de fortes manifestations des Gilets Jaunes, principalement en centre-ville des grandes agglomérations touchées par ce phénomène. Or, certaines entreprises ont par la suite décidé d’imposer aux salariés de poser un jour de congé pour ces journées non travaillées. Or, en principe, si l’employeur ne fournit pas de travail à son salarié et qu’il lui demande de ne pas venir travailler, il doit tout de même le rémunérer pour ce jour chômé. Il ne peut pas lui demander de poser un congé a posteriori. De la même manière, la manifestation des Gilets jaunes, ayant entraîné pour certaines entreprises l’obligation de fermer leurs portes quelques jours, ne peut être une excuse pour contraindre les salariés à rattraper leurs heures perdues. L’article L. 3121-50 du Code du travail est assez strict sur la question et précise les cas pour lesquels les heures perdues peuvent effectivement être récupérées. Or, le cas du mouvement des Gilets jaunes ne rentre pas dans ces trois hypothèses. Il en va tout de même différemment si le salarié devait venir travailler mais qu’il a été bloqué par un barrage. Dans ce cas, et quand bien même ce n’est pas de la faute de l’employé, ce dernier devra poser une journée ou bien la rattraper puisque ce cas de figure rentre dans le cas d’une force majeure prévu dans le Code du travail. Le rattrapage des heures non travaillées doit néanmoins se faire de manière progressive, à hauteur d’une heure par jour au maximum, et sur une durée de 12 mois.
L’activité partielle, la solution face aux conséquences de la manifestation des Gilets jaunes
Face aux conséquences importantes de la manifestation des Gilets jaunes sur l’activité des entreprises, la question s’est posée pour les employeurs de savoir comment agir. Quelle position adopter si l’on s’aperçoit que le mouvement des Gilets jaunes va ralentir l’activité professionnelle, cette dernière ne pouvant donc pas s’exercer correctement ? Dans le cas des Gilets jaunes, les manifestations de rue sont légions et empêchent ainsi l’accès à de nombreux commerces et boutiques. La solution pour faire face à cette situation est de placer les salariés de l’entreprise en activité partielle. Cette dernière, autrement appelée chômage partiel, répond à des principes clairement définis par le Code du travail. Ces salariés seront indemnisés :
- soit par l’Etat s’il considère que l’entreprise était effectivement contrainte à réduire ou annuler son activité
- soit directement par l’employeur, si l’Etat estime que cette contrainte n’était pas véritablement justifiée.
![]()

Nullité de la transaction de rupture après une remise en main propre du licenciement
Nullité de la transaction après la remise en main propre de la lettre de licenciement
En droit du travail, on appelle transaction le contrat par lequel salarié et employeur mettent un terme, par concessions mutuelles, à toute contestation antérieure ou à naître, en lien avec la rupture du contrat de travail. Elle est encadrée par l’ article 2044 du Code civil.
Dans un arrêt de Cour de cassation en date du 10 octobre 2018, la Haute juridiction a estimé qu’une transaction ayant lieu après la rupture du contrat de travail n’est valable que si le licenciement a été notifié par voie de courrier recommandé avec avis de réception.
Déroulement des faits
Toute transaction présuppose que le contrat de travail ait été rompu au préalable puisque son objet est précisément de mettre un terme définitif à toute possibilité de contestation liée à la rupture du contrat. Par son biais, les deux parties s’entendent pour ne pas remettre en cause de quelque manière que ce soit la décision prise ni aucune disposition contractuelle.
En l’espèce, un salarié se fait licencier par son employeur et signe le reçu de remise en main propre de la lettre de licenciement. Deux mois après le licenciement du salarié, l’employeur décide de conclure avec ce dernier un protocole transactionnel. Le salarié signe ce protocole puis en conteste la validité en saisissant les Prud’hommes.
La Cour d’appel saisie de cette affaire (en l’occurrence la Cour d’appel de Basse-Terre) considère que la transaction est valable puisqu’elle a été conclue à la suite de la notification du licenciement au salarié. Elle déboute le requérant de sa demande.
Le protocole transactionnel : un acte soumis à un strict formalisme
Le salarié forme un pourvoi en cassation. Au visa de l’ article L. 1231-4 du Code du travail et L. 1232-6 de ce même Code, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que cette transaction a été conclue par les deux parties en l’absence de notification du licenciement par voie de lettre recommandée avec avis de réception. De ce fait, il en résulte que la transaction est nulle.
La Jurisprudence part du principe qu’une transaction peut tout à fait être valable. Encore faut-il en fixer les contours. En la matière, la Cour de cassation vient apporter une lumière sur le formalisme devant entourer cette rupture afin de rendre la transaction valable.
La question qui était posée aux juges était ici de savoir si une transaction conclue après la notification d’un licenciement par remise en main propre était ou non valable.
Pour répondre à cette question, les juges ont établi que cette transaction, afin d’être valable, doit être conclue après la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. En l’absence de ce formalisme, la transaction est donc considérée comme nulle. Une simple remise en main propre au salarié, même contre signature, ne suffit pas.
Cette solution respecte tout particulièrement le formalisme tel qu’imposé par l’article L. 1232-6 du Code du travail et selon lequel l’employeur est tenu de notifier le licenciement au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une volonté de protéger le salarié licencié
Cette position de la part des juges n’est pas isolée. En effet, elle vient confirmer sa position constante, notamment dans un arrêt rendu le 5 mai 2010.
On pourrait légitimement se demander quelles sont les raisons d’une telle décision, dans la mesure où on pourrait penser qu’une remise en main propre suffit pour que le salarié prenne connaissance de son licenciement. En réalité, il apparaît que l’avantage de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception est de permettre au salarié licencié d’avoir une pleine et entière connaissance des motifs de son licenciement. Or, cela n’est pas forcément le cas lorsque le licenciement est notifié au salarié par une remise en main propre. L’objectif des juges est donc de protéger le salarié licencié, la transaction ayant pour conséquence de rendre impossible toute contestation. Cela ne remet nullement en cause la validité de tout licenciement mais bien de toute transaction conclue après le licenciement. Il est ainsi acquis de manière constante que la notification au salarié de son licenciement par une lettre remise en main propre ne requalifie pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc hautement conseillé aux employeurs de notifier le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception afin de pouvoir conclure une transaction postérieurement.
![]()

Le CDD : Ce qu’il faut savoir
Ordonnances macron : Quels changements pour le contrat à durée déterminée (CDD) ?
La réforme du Code du travail voulue par le Président de la République Emmanuel MACRON s’est traduite par la présentation le 31 août 2017 de 5 ordonnances, présentées le 22 septembre suivant en Conseil des Ministres. Parmi ces 5 ordonnances, la 3e relative à la « prévisibilité et sécurisation des relations de travail » vise à réformer le régime légal des contrats de travail temporaire ainsi qu’aux CDD (contrats à durée déterminée) conclus après leur publication (soit après le 23 septembre 2017), et en particulier concernant le rôle renforcé pour la négociation au niveau des branches sociales en ce qui concerne sa durée, son renouvellement, son délai de carence et les règles applicables en matière de requalification en CDI (contrat à durée indéterminée). L’orientation donnée par ces ordonnances est donc clairement celle de la primauté accordée à la négociation au niveau des entreprises ou des branches.
1. Le pouvoir conféré aux partenaires sociaux de fixer la durée totale du CDD
L’article 1242-8 du Code du travail prévoyait jusqu’à l’entrée en vigueur des ordonnances MACRON que le CDD ne pouvait « excéder dix-huit mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements ». Or, ce texte modifié par l’article 25 de l’ordonnance susvisée prévoit désormais que la durée maximale du CDD peut être déterminée librement et sans plafond légal dans le cadre d’une négociation conventionnelle entre partenaires sociaux, à l’exception des CDD visant à recruter un ingénieur ou cadre en vue de la réalisation d’un projet défini visé par l’article L1242-2 6° du Code du travail, ainsi qu’aux contrats conclus pour favoriser le recrutement de personnes en situation de chômage ou en complément de formation professionnelle.
Cette mesure vise clairement à encourager les entreprises à recruter à moindre risque afin de créer des postes « à tout prix ». Autrement dit, le choix politique effectué est celui de privilégier l’emploi, même précaire sur du moyen/long terme, par rapport au chômage. Il conviendra tout de même de suivre l’évolution de la jurisprudence avec intérêt à ce sujet, puisque la chambre sociale de la Cour de cassation considère actuellement et de manière constante, que le CDD ne peut « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».
En l’absence de durée maximale fixée conventionnellement au niveau de la branche, la durée légale de 18 mois reste tout de même applicable (renouvellement compris), sauf pour certains cas particuliers, comme notamment le contrat à durée déterminée conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un nouveau salarié, pour des travaux urgents imposés par le principe de sécurité ou de précaution, le départ définitif d’un salarié, ou encore une variation exceptionnelle du volume d’activité.
2. La détermination du nombre maximal de renouvellements par accords de branches
Depuis 2015, un CDD pouvait être renouvelé deux fois (une seule fois auparavant) dans la limite d’une durée totale de 18 mois. Désormais, le principe légal fixé par l’article 26 devient celui de la négociation ou de l’accord de branche comme déterminé par l’article L1243-13 du Code du travail modifié, donnant pouvoir aux partenaires sociaux pour déterminer le nombre maximal de renouvellements, sans plafond fixé par les textes légaux. A défaut d’accord conventionnel et seulement dans ce cas, le principe restera celui d’une limitation à deux renouvellements consécutifs du CDD.
3. La négociabilité de la durée du délai de carence
Concernant les modalités et la durée du délai de carence, les ordonnances viennent fixer le même principe de négociation entre partenaires sociaux, puisque les conventions de branche ont désormais pouvoir de fixer les règles applicables (article 27 de l’ordonnance).
Toutefois, ce principe est à nuancer par le fait que l’article 27-1 de cette même ordonnance précise que ce délai de carence doit impérativement être déterminé en jours ouvrés : « les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement ».
Ici également, à défaut d’accord négocié par les partenaires sociaux, l’article L1244-3-1 du Code du travail reste pleinement applicable, soit un délai de carence fixé à 1/3 du contrat lorsque le CDD (renouvellements inclus) est d’une durée inférieure à 14 jours, ½ en cas contraire.
Enfin, il convient de souligner que les conventions de branche pourront déterminer des situations pour lesquelles le délai de carence n’est pas applicable.
4. Obligation de transmission de l’employer : fin de la requalification automatique en CDI
Il ressortait des dispositions de l’article L1242-12 et L1242-13 du Code du travail ainsi que de la jurisprudence constante (par exemple : Cass. Soc. 17/06/2005, pourvoi 03-42.596), que l’employeur doit dans les deux jours ouvrables suivant la signature du contrat à durée déterminée transmettre le contrat par écrit et mentionnant le motif précis de signature. La sanction en cas de non respect de ces dispositions était celui de la requalification de plein droit en contrat à durée indéterminée (CDI).
Désormais et depuis l’entrée en vigueur des ordonnances, cette absence de transmission dans le délai légal de 2 jours ne constitue plus à elle seule un motif de requalification (article 4-V et VI de l’ordonnance numéro 3), remettant ainsi en cause la jurisprudence établie. Mais la situation n’en demeure pas moins floue, et il est à prévoir un contentieux foisonnant sur lequel les juges devront statuer dans les mois à venir.
Seule demeure certain dans ce cas le maintien d’une indemnité au profit du salarié, à la charge de l’employer, et qui est plafonnée à un mois de salaire. Une indemnité qu’il convient de distinguer de celle prévue par l’article L1245-2 du Code du travail (indemnité de requalification). Il est à noter d’ailleurs que l’articulation de ces deux indemnités, et notamment les règles en matière de cumul de celles-ci, sont loin d’être claires…
![]()

Attention à l’alcool au volant et encore plus en cas de récidive !
Le taux d’alcool autorisé dans le sang par la loi est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d’air expiré pour les jeunes conducteurs.
Le taux a été abaissé le 1er juillet 2015 à 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d’air expiré. Le code de la route prévoit une amende de 135 € et un retrait de 6 points sur votre permis de conduire. Un retrait du permis de conduire lui-même est également possible.
L’alcool est mesuré par un éthylomètre homologué ou avec une analyse de sang. L’éthylomètre (ou éthylotest) mesure le taux d’alcool dans l’air expiré et la prise de sang mesure le taux d’alcool dans le sang.
Le comportement du conducteur en état d’ivresse au volant n’est plus le même que lorsqu’il est à jeun, ses réflexes étant amoindris.
S’agissant d’une alcoolémie comprise entre 0,5 g et 0,8 g par litre de sang, on pourra retenir à votre encontre une contravention de 4ème classe avec une amende de 135 € et 6 points de retrait sur votre permis.
Une suspension de votre permis de conduire peut également être envisagée pour une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre de sang. Vous risquez alors de comparaître devant le Tribunal Correctionnel pour un délit, infraction grave au code de la route.
Avant cela, il vous sera notifié un retrait de 6 points sur votre permis de conduire et votre véhicule pourra être immobilisé sauf si vous avez un passager en état de conduire. Vous pouvez faire l’objet d’un retrait de permis de conduire jusqu’à 72 heures (rétention permis) ou bien d’une suspension administrative pouvant atteindre 1 an maximum et la mise en fourrière immédiate
Le tribunal correctionnel peut prononcer les peines prévues à l’article L 234-1 du code de la route, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à 2 années et une peine d’amende qui peut aller jusqu’à 4500 €.
Il pourra éventuellement vous imposer un stage de sensibilisation à la sécurité routière et la suspension prononcée par le tribunal peut aller jusqu’à 3 ans maximum. Une interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur peut être assortie à la peine prononcée.

Le Conseil Interministériel de la Sécurité Routière du 9 janvier 2018 prévoit de donner la possibilité à un conducteur contrôlé avec un taux d’alcool supérieure à 0,8 g par litre de sang avec une suspension de permis administrative par le préfet, de conduire pendant le temps de la suspension à condition d’équiper à ses frais son véhicule d’un EAD Ethylotest Anti-Démarrage cette mesure doit en principe s’appliquer courant de l’année 2018
Et en cas de récidive, c’est-à-dire si vous avez déjà été condamné pour des faits délictuels dans les 5 ans qui précèdent, le tribunal sera dans l’obligation de prononcer de manière automatique l’annulation de votre permis de conduire et donc l’obligation pour vous de repasser votre permis de conduire.
Autre mesure automatique que le tribunal ne pourra que constater : la confiscation de votre véhicule qui ne vous sera plus jamais rendu.
En ce qui nous concerne nous pourrons tenter de vous éviter l’emprisonnement.
![]()

Attention à la pose de panneaux photovoltaïques sur votre toiture !
De nombreux particuliers ont été floués en faisant installer des centrales photovoltaïques sur leur toiture.
L’argument commercial qui leur est avancé est alléchant, puisque des aides régionales leurs sont attribuées.
De plus, le tarif de rachat pratiqué par EDF est intéressant, leur permettant ainsi de rembourser le prêt contracté pour faire poser la centrale.
Les vendeurs par l’intermédiaire de leurs commerciaux ont sillonné la Réunion proposant un montage financier clé en main.
Les sociétés de pose de centrale photovoltaïque promettent aux particuliers une opération blanche pour laquelle elles s’occupent de tout, et notamment, de leur faire souscrire un prêt dans une banque partenaire, peu regardante.
Il leur est indiqué que le prêt va être intégralement remboursé par le rachat de l’électricité par EDF, électricité que leur centrale va produire et qu’ils vont pouvoir vendre à EDF au même montant que ce qu’ils déboursent pour le remboursement.
Tout est donc autofinancé, enfin c’est la promesse…
Mais, au fur et à mesure des remboursements du prêt et de l’établissement des factures à EDF, les particuliers se rendent compte que l’opération n’est absolument pas autofinancée et qu’ils en ont de leur poche, ce qui n’était pas prévu…
Pourtant, de nombreuses personnes m’expliqueront que, selon les calculs faits par les vendeurs devant eux, et par écrit, ils n’avaient rien à débourser.
Outre cette difficulté d’ordre financière, de nombreux panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas, et pire encore, créent des désordres sur les toitures des maisons, entraînant des infiltrations d’eau.
Plusieurs collectifs de particuliers se sont donc créés pour attaquer en justice ces montages et j’ai eu l’honneur d’assister certains d’entre eux.
Malheureusement, les sociétés déposent le bilan, les unes après les autres, et les liquidateurs judiciaires se rendent compte, petit à petit, qu’il n’existe aucun actif de nature à indemniser les personnes flouées.
Ni les sociétés d’assurances ni les services après-vente n’interviennent.
Les personnes ainsi trompées se retrouvent seules face à leurs difficultés, et très souvent, avec des prêts dont ils interrompent le remboursement en raison des dysfonctionnements des centrales, avec pour récompense, un fichage Banque de France et un huissier à la porte de leur domicile.
C’est en découvrant une faille dans le montage que le cabinet a demandé à la justice d’annuler de nombreux contrats, ce qu’il a obtenu dans plusieurs décisions… pour certaines, dispensant les souscripteurs du remboursement du prêt et pour d’autres, allant jusqu’à demander à la banque de rembourser les sommes versées par les particuliers.
![]()
