
Divorce et retrait du statut de réfugié
Retrait du statut de réfugié en cas de divorce
Le divorce est une cause de perte du statut de réfugié pour la personne qui en bénéficie. L’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 29 novembre 2019 en est un exemple frappant. En effet lorsque le statut de réfugié a été obtenu au titre de l’unité de famille, le CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit le retrait de ce statut par l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) en cas de divorce. Qu’en est-il vraiment ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
La Convention de Genève : document juridique clé pour le statut des réfugiés
Signée en 1951, la Convention de Genève relative au statut des réfugiés constitue un document juridique majeur et sert aujourd’hui de base de travail à tous ceux qui ont à analyser l’opportunité d’octroyer ce statut. Ce texte apporte une définition exhaustive de ce qu’on appelle “réfugié” et présente les droits de ces personnes ainsi que les obligations des Etats qui les accueillent, afin d’en assurer la protection.
Ratifiée par 145 Etats, cette convention fonctionne sur le principe du non-refoulement, autrement dit l’idée selon laquelle un réfugié ne doit pas être renvoyé dans son pays si sa vie ou sa liberté y est gravement menacée. Le droit international a intégré cette règle comme fondamentale et les personnes qui sont en demande de statut de réfugiés mettent en avant cet élément auprès des juridictions.
En l’espèce, un ressortissant russe d’origine tchétchène avait rejoint son épouse en France, cette dernière ayant obtenu le statut de réfugié. Au titre de l’unité de la famille, l’époux avait également obtenu ce statut par la suite. Or, à la suite d’une procédure de divorce, la question se posait de savoir si le statut de réfugié devait être maintenu ou bien retiré par l’OFPRA. C’est sur cette question que se sont penchés les juges du Conseil d’Etat le 29 novembre 2019.
Divorce et rupture de l’unité familiale : liberté d’appréciation de l’OFPRA
En principe, est considérée comme réfugiée toute personne qui craint, avec raison, de subir des persécutions dans son pays du fait de sa religion, de sa race, de sa nationalité ou bien de son appartenance à un groupe social ou du fait de ses opinions politiques. Aux termes de la loi internationale, il est admis que ce statut peut cesser définitivement si les circonstances qui ont permis de reconnaître le statut de réfugié ont pris fin. Dans ce cas, la personne qui a bénéficié du statut de réfugié ne peut plus continuer à refuser de réclamer la protection du pays dont elle est originaire et dont elle a la nationalité.
Ce principe est renforcé par l’article L. 711-4 du CESEDA qui prévoit que ” L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.”
En ce qui concerne le cas d’espèce, les juges avaient considéré qu’une personne ayant obtenu le statut de réfugié dans le cadre de l’unité de famille était susceptible de perdre son avantage à la suite d’une procédure de divorce. Cela constitue un changement de circonstances ayant légitimé la reconnaissance de cette qualité de réfugié au sens du droit international. L’OFPRA a dans ce cas de figure la liberté d’analyser le dossier du demandeur et d’apprécier, au regard des changements de circonstances dont il est question, l’opportunité de continuer à reconnaître la qualité de réfugié à la personne divorcée.
Vous souhaitez obtenir le statut de réfugié ou avez des interrogations quant à l’application du droit international des étrangers ? L’équipe d’Ake Avocats est à votre disposition pour vous accompagner.
Lire la suite
Collaboration bénévole de l’époux : aucun appauvrissement personnel
Collaboration bénévole de l’époux : aucune action pour enrichissement sans cause
Par un arrêt rendu le 17 avril 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la question de savoir si l’époux ayant participé bénévolement à l’activité de son conjoint pouvait agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause (autrement appelé enrichissement injustifié depuis la réforme du droit des obligations du 10 février 2016). Les juges ont estimé que les salaires, gains et indemnité de perte de revenus de l’époux, en tant qu’ils sont inclus dans la communauté légale, justifient que l’époux commun en biens ayant participé bénévolement à l’activité professionnelle de son conjoint ne soit pas en mesure d’agir pour enrichissement sans cause. Qu’en est-il de cette décision et quelles conséquences y sont rattachées ? Réponse dans cet article avec Ake Avocats.
Collaboration de l’époux et liquidation de la communauté
La Cour de cassation a souvent à se positionner sur les questions de liquidation de la communauté et de partage des opérations de comptes. En l’espèce, un agent d’assurance perçoit une indemnisation pour la réparation d’un préjudice financier en cours de mariage. Il utilise cette indemnité pour le financement d’une partie d’une nouvelle agence. En instance de divorce, son épouse, ayant travaillé pendant 18 ans au sein de l’agence appartenant à son conjoint sans jamais avoir perçu de salaire, demande la requalification de l’indemnité perçue par son ex-conjoint. La question concerne également celle de l’impact d’une collaboration bénévole d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint.
Les juges de Cour d’appel estiment que l’indemnité est un bien commun et que le conjoint est tenu d’une récompense à la communauté. Les juges considèrent que l’épouse est bénéficiaire d’une créance au titre de l’enrichissement sans cause, partant du principe que sa collaboration professionnelle bénévole n’a pas été prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire dont elle bénéficie. De son côté, la Cour de cassation estime que les gains et les salaires perçus par un époux font partie des biens communs et que de ce fait l’époux qui participe à l’activité professionnelle de l’autre ne subit pas d’appauvrissement personnel lui donnant le droit d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Qualification de l’indemnité et enrichissement sans cause
Sur la question de la qualification de l’indemnité, les juges sont particulièrement stricts. Ils considèrent que l’indemnité est un bien commun et non un bien propre à l’époux dès lors que sa source réside dans l’activité professionnelle de l’époux et qu’elle est destinée à compenser une perte de revenus. L’indemnité aurait été un bien propre si sa nature avait été de réparer un préjudice personnel à l’époux ou de remplacer un bien propre. L’article 1402 du Code civil fait d’ailleurs une application stricte de ce principe en prévoyant une présomption de communauté des indemnités perçues par les époux.
Le second apport de cet arrêt est d’ouvrir le débat sur la prise en compte de la collaboration bénévole des époux à l’activité professionnelle de leurs conjoints. Quand les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté, deux situations doivent être distinguées :
- soit l’entreprise de l’époux est un bien commun : dans ce cas, l’enrichissement sans cause est écarté puisque l’activité du conjoint profite directement à la communauté
- soit l’entreprise de l’époux est un propre au conjoint : le travail de l’époux bénévole profite alors directement en propre au conjoint entrepreneur. Pour prendre en compte cette contribution professionnelle, le juge intègre la valeur de ce travail dans le calcul du montant de la prestation compensatoire.
Au contraire, si les deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les juges admettent généralement que l’époux collaborateur bénévole peut prétendre à une indemnité au titre de l’enrichissement sans cause.
Vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour défendre vos intérêts en justice ? L’équipe d’Ake Avocats est à votre entière disposition pour vous accompagner tout au long de cette démarche.

Conséquences d’une déclaration de délaissement parental
Déclaration de délaissement parental : quelles conséquences ?
Remplaçant la déclaration d’abandon, la déclaration judiciaire de délaissement parental est une mesure qui a fait l’objet d’une adaptation par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 portant sur la protection de l’enfant. Cette mesure judiciaire n’est pas sans conséquences, tant sur l’exercice et l’attribution de l’autorité parentale que sur le lien de filiation entre l’enfant et le parent délaissant. Ake Avocats vous éclaire dans cet article sur les conséquences d’une déclaration de délaissement parental.
Le délaissement parental : à l’égard d’un ou de deux parents
Le Code civil prévoit, dans son article 381-2, que le délaissement parental peut être fait à l’égard d’un seul ou bien des deux parents. S’il a lieu à l’égard d’un seul parent, on parle alors de délaissement unilatéral. La Cour de cassation a récemment statué sur les conditions de déclaration de délaissement parental ainsi que sur ses conséquences, par deux avis en date du 19 juin 2019. Etaient plus précisément visées les conséquences d’une telle mesure judiciaire sur l’avenir de l’enfant en tant que pupille de l’Etat et sur la question d’une possible délégation d’autorité parentale.
Déclaration de délaissement parental : conditions préalables
La Cour de cassation a eu à statuer dans un premier temps sur la question de savoir quelles étaient les conditions du délaissement parental.
L’article 381-1 du Code civil dispose que :
« Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit ».
Le délaissement peut concerner les deux parents ou bien l’un seulement. Plus concrètement, les conditions précises pour qualifier un délaissement parental sont les suivantes :
- les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant des relations suffisantes pour pourvoir à son éducation ou à son développement
- l’enfant est délaissé depuis au moins 1 an au jour de l’ouverture de la requête en justice
- les parents n’ont pas été empêché d’une quelconque manière d’entretenir des relations suffisantes avec leur enfant.
S’agissant de la première condition, la Cour de cassation part du principe que les parents sont tenus de protéger l’enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, afin d’assurer son éducation et de garantir son bon développement. En l’absence de telles relations, la première condition est potentiellement remplie.
Déclaration de délaissement parental : conséquences
La déclaration de délaissement parental entraîne des conséquences tant sur le plan civil que pénal. Provenant du ministère public ou du service d’Aide sociale à l’enfance ayant recueilli l’enfant, cette mesure a deux conséquences majeures :
- d’une part, elle crée une délégation d’autorité parentale au bénéfice de l’organisme ayant accueilli l’enfant ou chez qui il est confié de manière temporaire
- d’autre part, il place l’enfant dans une position d’adoption immédiate.
Si le délaissement parental se fait à l’égard d’un seul parent uniquement, le tribunal ne prononce pas le délaissement parental à l’égard de l’autre parent dans la mesure où cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il en va de même si un membre de la famille de l’enfant a exprimé le souhait d’assumer la charge et l’entretien de l’enfant.
Dans l’absolu, le juge évite de prononcer une déclaration de délaissement parental. Il privilégie, lorsque cela est possible, d’autres mesures alternatives comme une délégation de l’autorité parentale ou il peut décider de confier l’enfant à un tiers de confiance choisi de préférence dans sa parenté. Le juge près le tribunal de grande instance peut également déchoir les parents de l’enfant de leurs droits parentaux, si ces derniers mettent en péril la moralité, la sécurité et/ou la santé de leur enfant.
Vous souhaitez avoir des renseignements ou vous souhaitez obtenir l’intervention d’un avocat ? Le cabinet Ake Avocats intervient en droit de la famille pour défendre vos intérêts en justice.

Donation en nue-propriété et sort du logement familial
Qu’en est-il de la protection du logement familial en cas de donation de la nue-propriété du logement avec réserve d’usufruit ?
Donation en nue-propriété du logement familial et protection du conjoint
Le Code civil est particulièrement strict sur la question du logement de famille : les époux ne peuvent pas l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels le logement de famille est assuré, ni des meubles meublants dont il est garni (article 215 alinéa 3 du Code civil). Néanmoins, cette disposition ne vaut que le temps du mariage. Que se passe-t-il alors en cas de donation de la nue-propriété du logement familial avec réserve d’usufruit ? Ake Avocats vous répond dans cet article.
Le logement familial : un statut particulier pendant le mariage
 Le droit de la famille et des régimes matrimoniaux confère au logement familial un véritable statut, destiné à protéger l’époux contre toute action entreprise par son conjoint et pouvant porter atteinte au maintien de la famille dans le logement.
Le droit de la famille et des régimes matrimoniaux confère au logement familial un véritable statut, destiné à protéger l’époux contre toute action entreprise par son conjoint et pouvant porter atteinte au maintien de la famille dans le logement.
En la matière, l’article 215 alinéa 3 du Code civil prévoit une véritable protection pour le logement de la famille ainsi que les meubles meublants dont il est garni. Il est en effet prévu que les époux ne peuvent pas l’un sans l’autre disposer des droits sur ces différents éléments. La conséquence en est que le conjoint qui n’a pas donné son accord à l’acte peut en demander l’annulation en justice.
Cet article protecteur du Code civil s’applique de manière extensive à tous les actes compromettant directement ou indirectement le bon maintien de la famille dans le logement familial durant le mariage. Cela ne vaut donc pas en principe pour toute situation hors mariage (divorce, PACS, concubinage…).
La protection du logement ne vaut que pendant le mariage
Par un arrêt rendu le 22 mai 2019, la Cour de cassation avait à se positionner sur la question de savoir si l’article 215 du Code civil s’applique aussi en dehors du mariage.
En l’espèce, deux époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Un des époux avait conclu une donation de la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propres, au bénéfice de ses enfants issus d’un ancien mariage. Cet époux avait également accordé une réserve d’usufruit à son profit sur le logement familial.
Les deux époux ont ensuite pris la décision de divorcer. Durant l’instance de divorce, l’époux décède. Son conjoint assigne alors en justice les enfants bénéficiaires de la donation afin d’obtenir l’annulation de cette libéralité. L’épouse fait valoir le fait que le bien donné constitue le logement familial et qu’elle n’a pas exprimé son consentement à cet acte.
La Cour d’appel fait droit à sa demande mais la Cour de cassation en décide tout autrement. Cette dernière considère en effet que la loi prévoit un statut de protection pour le logement de famille tant que les époux partagent une communauté de vie, donc uniquement pendant le mariage. Or en l’occurrence l’acte consenti n’avait aucunement porté atteinte à la jouissance et à l’usage du logement de famille par l’épouse durant le mariage. Les juges de la Cour de cassation décident donc de refuser l’annulation de la donation en nue-propriété du logement familial avec réserve d’usufruit.
Vous avez consenti une donation sur le logement familial au profit de vos enfants issus d’un précédent mariage et vous souhaitez connaître vos droits ? Vous avez un litige en droit de la famille ? L’équipe d’Ake Avocats est à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans votre action en justice.
![]()

Office du juge et droit de visite médiatisé des grands-parents
En matière de droit de visite médiatisé, l’office du juge est différent selon que ce droit bénéficie aux parents ou aux grands-parents.
Droit de visite médiatisé des parents et des grands-parents : des conditions différentes
Par un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation s’est positionnée sur l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé des parents et des grands-parents sur l’enfant. Les juges ont conclu que si le juge était tenu de fixer la durée des rencontres pour toute visite médiatisée de l’un des parents, il en allait autrement en ce qui concerne les grands-parents. Zoom sur cette divergence de conditions quant au droit de visite médiatisé et explications avec Ake Avocats.
Office du juge dans la fixation du droit de visite médiatisé au bénéfice des grands-parents
Le 13 juin 2019, la chambre civile de la Cour de cassation avait à se prononcer sur le rôle du juge dans la fixation des modalités du droit de visité médiatisé octroyé aux grands-parents.
En l’espèce, une grand-mère avait obtenu un droit de visite et d’hébergement de ses petits-enfants dans un lieu médiatisé et organisé selon des modalités précises définies par les personnes travaillant au sein de l’espace rencontre.
Les parents des enfants avaient alors contesté cette décision et argué du fait que le juge avait manqué à son obligation de fixation de la durée des visites, de sorte que le fait de déléguer cette tâche aux accueillants du point rencontre avait violé l’article 371-4 du Code civil.
La question se posait alors de savoir quel était l’office du juge dans la fixation du droit de visite médiatisé au bénéfice de grands-parents. Le juge est-il tenu de fixer la durée de la rencontre accordée à un grand-parent ? L’intérêt de la décision de la Cour de cassation réside dans le fait qu’à notre connaissance il s’agit du premier arrêt se positionnant sur l’office du juge dans le cadre du droit de visite médiatisé pour les grands-parents.
Ainsi, la Cour rappelle que chaque enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, comme le précise l’article 371-4 du Code civil, en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. Si le juge est effectivement tenu de préciser les modalités d’exercice du droit de visite médiatisé au profit des parents sur l’enfant, il en est dispensé lorsque ce droit est accordé aux grands-parents.
Droit de visite médiatisé : des modalités différentes entre parents et grands-parents
Lorsque le droit de visite médiatisé est au bénéfice des parents, l’article 1180-5 du Code de procédure civile s’applique. Il prévoit que le juge doit préciser les modalités d’exercice du droit de visite au profit des parents dans un espace de rencontre. Si les parents sont les bénéficiaires de ce droit, le juge est donc tenu de déterminer précisément la durée et la périodicité des rencontres. Il s’agit alors de l’office du juge en matière de droit de visite médiatisé des parents.
En revanche, la solution est différente lorsque ce droit de visite est accordé aux grands-parents sur leurs petits-enfants. Dans ce cas, l’article 1180-5 du Code de procédure civile ne s’applique pas et le juge est donc autorisé à déléguer la fixation des modalités concrètes du droit de visite au personnel accueillant dans le point de rencontre. Pourquoi une telle différence ? Les juges font ici preuve de pragmatisme en prenant en considération les difficultés inhérentes à l’organisation des droits de visite dans les espaces de rencontres médiatisés.
C’est sans nul doute pour cette raison que les juges de la Cour de cassation ont décidé de ne pas étendre l’article 1180-5 du Code de procédure civile aux modalités de fixation du droit de visite médiatisé des grands-parents.
Vous avez un litige en droit de la famille ? Vous souhaitez obtenir un droit de visite en tant que grands-parents ? Ake Avocats est disponible pour vous écouter et vous assister dans vos démarches juridiques.
![]()

Circulaire du 24 avril 2019 encadrant les régimes matrimoniaux et partenariats
Le 24 avril 2019, une circulaire est venue présenter les régimes matrimoniaux et partenariats enregistrés dans la sphère européenne. Zoom avec Ake Avocats
Régimes matrimoniaux et partenariats : nouvelle circulaire du 24 avril 2019
Le 24 avril 2019, le ministère de la Justice a émis une circulaire présentant les règlements européens n° 2016/1103 et 2016/1104 visant à renforcer la coopération en matière de régimes matrimoniaux et de partenariats enregistrés. Ainsi, cette circulaire apporte des éclairages sur les règles du régime primaire et élargit notamment la possibilité de choisir son régime conventionnel. Quelles sont les nouveautés apportées par cette circulaire ? Réponse avec Ake Avocats.
Une présentation des règlements européens sur les régimes matrimoniaux
La circulaire du 24 avril 2019 vise à présenter les deux règlements européens entrés en application le 29 janvier 2019 (n° 2016/1103 et n° 2016/1104) et qui concernent les régimes matrimoniaux présentant un lien avec l’étranger. Ces règlements visent plus particulièrement tous les couples mariés ou unis par un partenariat célébré dans un Etat membre de l’Union européenne.
Ainsi, la circulaire vise à présenter de manière exhaustive les règles encadrant l’acceptation et la reconnaissance juridique de ces actes conclus à l’étranger. Ces règlements ne concernent que le mariage et le partenariat, sans viser la succession du partenaire ou du conjoint. Sont également uniquement concernées toutes les procédures de mariages et de PACS depuis le 29 janvier 2019. Ainsi, toutes celles ayant eu lieu avant cette date ne sont pas concernées par la circulaire et les règlements.
Les Etats membres de l’Union européenne ayant choisi de participer à cette coopération renforcée appliquent la circulaire, ce qui permet aux couples ayant conclu un mariage ou un PACS à l’étranger de voir reconnaître plus facilement leur statut en France.
Le choix de la loi applicable aux époux et aux partenaires
La circulaire précise que les partenaires enregistrés disposent désormais de la liberté de choisir la loi applicable à leur partenariat. Cela n’était pas le cas précédemment, le Code civil imposant d’appliquer les dispositions de l’Etat où l’autorité a procédé à l’enregistrement du PACS.
En outre, la circulaire estime qu’il est désormais possible pour le couple marié ou pacsé de choisir entre se soumettre au régime légal ou bien à un régime conventionnel. Concrètement, les époux peuvent décider de choisir un régime conventionnel du droit français plutôt que d’être soumis à la loi étrangère du lieu où a été célébrée leur union.
Il est à noter que ces décisions devront être librement acceptées et reconnues dans tous les Etats qui participent à la coopération renforcée.
Une circulaire accompagnée de 4 fiches pratiques
La circulaire comporte 4 fiches destinées à comprendre le champ d’application des deux règlements, à fixer la compétence des autorités, à déterminer la loi applicable et à renforcer les règles applicables à l’acceptation, la reconnaissance et la force exécutoire des décisions et actes authentiques.
Véritables outils pratiques, ces fiches techniques sont conçues de manière pédagogique, dans un souci de bonne compréhension.
- la première présente les champs d’application des 2 règlements européens et permet leur articulation avec la Convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux
- la seconde vise la compétence des Etats et des autorités
- la troisième fiche concerne plus particulièrement la loi applicable aux mariages et partenariats enregistrés, en droit international. En effet, elle permet de régler certains conflits de lois lorsque le mariage ou le PACS est conclu à l’étranger et que les époux ou partenaires souhaitent par la suite faire reconnaître l’acte en France
- la quatrième présente le processus de reconnaissance des actes et les déclarations qui acquièrent force exécutoire.
À lire : Zoom sur l’exonération fiscale des heures supplémentaires
![]()

Infections nosocomiales : quels sont vos droits ?
Les infections nosocomiales, contractées dans des établissements de santé, touchent 1 patient sur 20 en France. Quels sont vos droits et les recours possibles ?
Maladies nosocomiales : quels sont vos droits ?
Les maladies nosocomiales ne sont pas des situations exceptionnelles. On estime qu’1 patient sur 20 en contractera une dans le cadre de son hospitalisation. L’indemnisation de ces victimes s’est grandement améliorée avec le temps, notamment grâce à la Loi Kouchner en date du 4 mars 2002. Néanmoins, force est de constater que les victimes peinent encore aujourd’hui à obtenir gain de cause. Victimes d’infections nosocomiales, quels sont vos droits ? Quelle procédure pouvez-vous engager ?
Maladie nosocomiale : définition
Qu’appelle-t-on maladie nosocomiale ? Il s’agit d’une infection contractée dans un centre hospitalier, principalement dans un service de réanimation, à la suite d’un soin quelconque. Soit l’infection a pour origine une contamination interne au patient, soit externe (elle peut alors provenir d’un autre patient, du personnel soignant ou des instruments utilisés).

La loi Kouchner, au service d’une meilleure indemnisation
Promulguée le 4 mars 2002, la loi Kouchner a transformé en profondeur le régime de prise en charge des dommages subis par les patients. Selon les cas concernés, ces préjudices peuvent concerner également les infections nosocomiales, à l’exception de celles survenues avant le 5 septembre 2001.
Concrètement, deux situations se posent :
- soit le préjudice subi est la conséquence d’un aléa thérapeutique, et non pas d’une faute. La solidarité nationale prendra alors en charge le préjudice dans le cas où le taux d’incapacité est au moins égal à 24 %. Vous devez également être dans l’incapacité constatée de reprendre votre métier exercé avant l’accident, ou bien être en arrêt de travail depuis au moins 6 mois consécutifs. La demande d’indemnisation par la solidarité nationale est à adresser à l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux)
- soit vous êtes la victime d’une erreur médicale ou bien d’une faute de l’établissement qui vous a reçu en tant que patient. Dans ce cas, la charge de la preuve est inversée : vous n’aurez pas à démontrer l’existence d’une faute. Il incombera à l’établissement médical de prouver l’absence de faute.
Avant toute action, pensez à déclarer ce sinistre auprès de votre compagnie d’assurance et récupérez votre dossier médical en adressant une demande à la direction de l’établissement. Vous avez le droit d’avoir accès à votre dossier et d’en faire des photocopies.
Saisine de la CCI
Si vous avez eu à souffrir d’une infection nosocomiale, vous avez tout à fait la possibilité de saisir la CCI, ou Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Vous devez agir dans un délai maximal de 10 ans à partir du jour où vous avez subi le dommage. Tout au long de la procédure, vous devrez informer la CCI de l’action en justice et de ses suites. La saisine de la CCI suspend tous les délais de recours contentieux et de prescription.
Pour en faire la demande, il vous suffit de remplir le formulaire Cerfa n° 12245*03, à envoyer à la CCI de votre lieu de résidence, par courrier recommandé avec avis de réception.
Pour obtenir une meilleure indemnisation, n’hésitez pas à vous rapprocher d’un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’infections nosocomiales et d’erreurs médicales. Ce dernier vous accompagnera dans la procédure afin d’agir en réparation du préjudice subi.
À lire : Vous êtes victime d’une erreur médicale
![]()
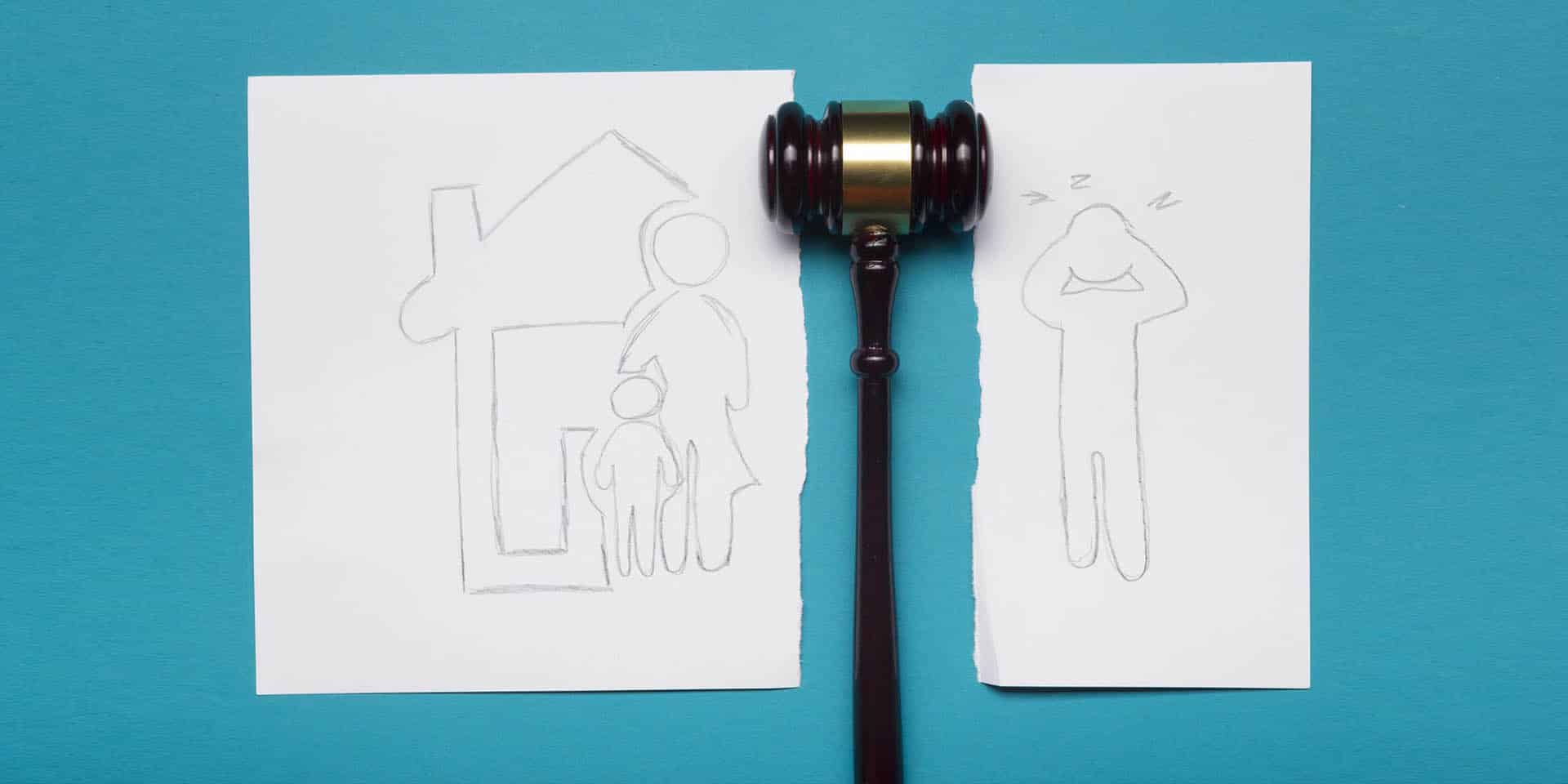
Le sort du domicile conjugal en cas de divorce des époux
La protection du domicile conjugal dans le cadre du divorce
Une procédure de divorce emporte des conséquences plus ou moins importantes pour l’ensemble de la famille, et notamment le couple. Le sort du domicile conjugal, ancien lieu de communauté de vie entre les époux au sens de l’article 215 du Code civil, est particulier. En effet, en cas de conflit, c’est au juge de fixer cette résidence selon les intérêts de la famille. Que devient le domicile conjugal en cas de divorce des époux ? Est-il possible de le vendre ? Cet article fait la lumière sur ces questions.
Procédure de divorce : un époux peut-il vendre le domicile conjugal ?
Sur la question de savoir si un des époux peut, de sa propre volonté, procéder à la vente du logement ayant constitué le domicile conjugal, la législation française est particulièrement claire. L’article 215 du Code civil, dans son troisième alinéa, précise à cet effet que la vente du domicile conjugal durant la procédure de divorce suppose l’accord des deux époux. Il en va de même des meubles composant ce logement. Ainsi, si l’un des époux n’a pas donné son consentement à la vente du bien, il est en droit de demander l’annulation de l’acte. Pour agir en nullité il dispose d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte de vente. Dans tous les cas, il lui est impossible d’agir au-delà d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Si les deux époux étaient locataires du domicile conjugal et qu’ils entament une procédure de divorce, ils ne peuvent pas, l’un sans l’autre, résilier le bail portant sur le logement familial. Les deux époux sont en effet cotitulaires du bail, en vertu de l’article 1751 du Code civil.
Les exceptions à l’accord des deux époux sur le domicile conjugal
Il peut arriver qu’un époux souhaite vendre le domicile conjugal ou mettre un terme au bail sans pour autant obtenir l’accord de son conjoint. Dans le cadre d’une procédure de divorce il n’est en effet pas rare de voir apparaître des divergences de ce type. Comment faire pour procéder tout de même à l’acte sans encourir la nullité ? L’article 217 du Code civil peut s’appliquer dans certaines situations et intervient à défaut de consentement des deux anciens conjoints. Il s’agira principalement de savoir si le refus s’oppose à l’intérêt de la famille. Ainsi, un époux peut parfaitement être autorisé à vendre le logement familial sans l’accord de son conjoint si ce dernier n’est pas en mesure de manifester sa volonté ou que son désaccord est injustifié au regard de l’intérêt de la famille. C’est par exemple le cas si un des époux connaît une situation importante de surendettement uniquement susceptible d’être apurée par la vente du domicile conjugal, après que ce dernier ait vendu ses biens propres. Dans ce cas, la vente est opposable à l’autre époux qui a refusé l’acte mais ne l’engage pas dans le paiement d’une quelconque dette rattachée à l’acte. Il est à noter que l’attribution de la jouissance du logement familial à l’un des deux époux n’empêche pas l’autre époux d’en demander la vente.
![]()

Médiation : Comment gérer ses problèmes de voisinage
Médiation : Comment gérer ses problèmes de voisinage
Comme prévu dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Et pourtant, on estime que 2 français sur 3 subissent ou subiront un jour des nuisances de voisinage, véritable fléau de la densification croissante des villes et campagnes. S’il est souvent considéré qu’elles constituent une fatalité fasse à laquelle il est difficile d’agir, le droit ne demeure pas en reste et offre des possibilités d’action permettant de faire valoir ses droits, et cesser ces problématiques qui sont parfois susceptibles de dégrader fortement votre quotidien, privant les victimes d’une jouissance paisible de leur logement qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement. Car si ce phénomène touche davantage les copropriétaires, il n’épargne pas les logements individuels et les quartiers pavillonnaires.
La jurisprudence au secours de la quiétude au quotidien
C’est à travers un arrêt rendu le 19 novembre 1986 que la 2e chambre civile de la Cour de cassation est venue créer la notion de trouble anormal de voisinage (pourvoi 84-16.379): “Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, instaurant un double principe d’exonération de responsabilité pour le résident dont les activités demeurent en-deçà d’un seuil de tolérance, alors que la 2e permet l’engagement automatique de la responsabilité de celui qui dépasse ce même seuil : le fait générateur est ainsi plus important que le préjudice en lui-même.
En effet, la vie en communauté pousse à établir un rapport d’équilibre entre les nuisances rendues nécessaires par la vie quotidienne (qu’elles soient sonores, visuelles ou olfactives). L’abus de droit de propriété et le trouble anormal de voisinage sont ainsi caractérisés lorsque cet équilibre est rompu, et ce même si aucune faute caractérisée n’est commise. La Cour d’appel d’Amiens est venue préciser dans un ancien arrêt de 1932 que nul n’est en droit d’imposer à ses voisins « une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage ». De la musique à fond à toute heure, aux hurlements répétés, bruits de meubles ou de coups intempestifs, barbecue sur le balcon, commerce ou activités mitoyennes bruyantes… les exemples possibles sont nombreux.
Quelle procédure engager face aux troubles de voisinage ?
La première démarche à engager est bien entendu amiable. Il est possible qu’avec un simple dialogue les choses puissent rentrer dans l’ordre, et que le voisin responsable des nuisances n’ait tout simplement pas conscience (volontairement ou non) du préjudice qu’il provoque. Si le dialogue verbal ne suffit pas, il convient alors de constituer un dossier écrit à travers l’envoi dans un premier temps d’un courrier simple, suivi d’une mise en demeure avec rappel de la législation (notons ici que le tapage diurne est tout aussi prohibé que le tapage nocturne!) par courrier recommandé avec accusé de réception si la situation n’évolue pas favorablement.
Lorsque cette première phase directe entre la victime et le responsable des nuisances ne suffit pas, il est alors possible de faire appel à un médiateur, dont la saisie s’effectue directement en mairie. Ce médiateur convoque alors les parties et tente depuis son regard extérieur et en terrain neutre de trouver une solution durable. Mais il ne dispose d’aucun pouvoir de police ou même de contrainte : il ne peut obliger les parties à se rendre à sa convocation. Si la démarche reste amiable, son caractère plus officiel permet généralement de régler le conflit.
Le troisième recours possible en cas d’échec est alors le maire de la commune, garant de la tranquillité publique et en mesure de diligenter les moyens nécessaires pour constater et faire cesser le trouble, notamment grâce aux forces de police municipale (police du quotidien et du cadre de vie), mais également des autres forces de sécurité disponibles et éventuellement de spécialistes tels que des acousticiens et inspecteurs de salubrité publique. Lorsqu’ils constatent le trouble anormal de voisinage, ils sont en mesure de prendre des mesures immédiates de rappel à l’ordre et en dernier lieu de saisir le Procureur de la République.
L’ultime recours reste celui porté devant les juridictions civiles (saisie du tribunal d’instance ou de grande instance, si le préjudice estimé est supérieur à 10 000€), ou pénales (dépôt de plainte) afin de faire valoir ses droits devant un juge, et obtenir une indemnisation ainsi qu’une sanction financière pour le responsable.
Enfin, rappelons que le propriétaire bailleur est responsable de son locataire, qui n’est pas exonéré des obligations de jouissance paisible sur le motif qu’il n’est pas propriétaire. Ainsi, depuis la loi 2007-297 du 5 mars 2007, le propriétaire est en droit de résilier le bail à tout moment en cas de troubles de voisinage établis. Lorsqu’il n’intervient pas auprès de son locataire pour faire cesser le trouble, il peut même engager sa responsabilité à l’égard du tiers lésé.
![]()

Le nouveau DCM : divorce par consentement mutuel
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous seing privé, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire (article 1374 du Code civil).
Il n’y a donc plus de phase judiciaire ; chaque conjoint est dans l’obligation d’avoir son propre avocat contrairement, à ce qu’il pouvait se passer sous l’emprise de l’ancien DCM où les deux époux pouvaient avoir le même avocat.
Cette obligation de se faire assister chacun par un avocat différent permet de garantir un consentement libre de toute pression et éclairé de chacun des époux.

Il sera établi une convention qui détermine les modalités de règlement des effets du divorce, déposée aux rangs des minutes du notaire, qui lui donnera date certaine et force exécutoire.
Le notaire n’est pas là pour contrôler l’acte des avocats ni pour s’assurer du consentement des époux, ni même pour vérifier l’équilibre de la Convention.
Les parties et leurs avocats n’ont pas non plus à se présenter devant le notaire.
Il faut savoir que cette procédure est rapide mais qu’elle nécessite que les époux soient d’accord sur l’ensemble des éléments du divorce car en cas de désaccord, les échanges et pourparlers entre avocats pourraient très probablement rallonger les délais de procédure.
L’acte d’avocat sera notifié par chacun des avocats à son client par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet envoi fait courir un délai de réflexion de 15 jours à l’issue duquel l’acte doit être adressé à un notaire pour enregistrement.
Ce divorce ne se résume pas à la rédaction des actes ; il inclut toutes les négociations préalables nécessaires : le Conseil, la stratégie et le travail de fond de l’avocat sont très importants puisqu’il n’y aura aucun contrôle judiciaire de l’équilibre de l’acte.
![]()
